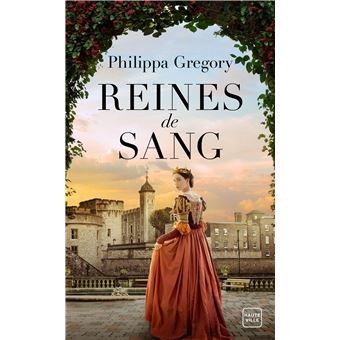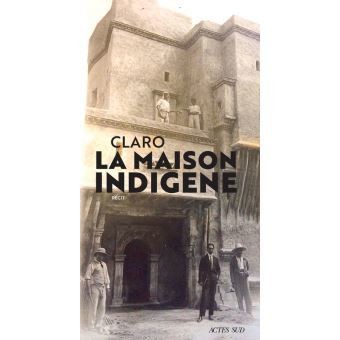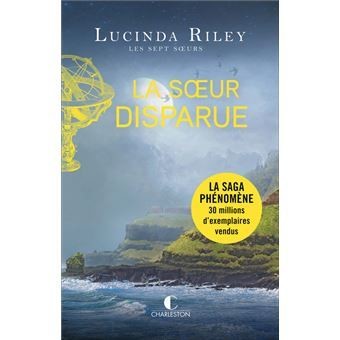Le kiné de campagne Blog de poésie,d'amour humain, belles ballades poétiques,des photos des villages corses.Littérature.
Blog de poésie,d'amour humain, belles ballades poétiques,des photos des villages corses.Littérature.
Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Discussion (472)
· Poésies (201)
· Mes ballades (83)
· MUSIQUE (112)
· UN PEU DE CORSE, la langue d'ici (40)
· HANDICAP (13)
· PHOTOS (17)
· MAXIMES,REFLEXIONS (33)
· Dansons,dansons, (23)
· Blagues (16)
· RANDONNÉE CORSE – POZZI DE BASTELICA
· POESIE de mon pays
· La Conspiration de l'ombre
· Dardanus.
· La Traversée des temps - Paradis perdus
· POESIE d'été
· Les glacières de Cardo et de Ville-di-Pietrabugno
· OLMO
· Rando:Cima di e Follicie
· LA PANTHÈRE DES NEIGES.SYLVAIN TESSON
· Avant elle
· VENISE!!
· Vie pour Vie
· Randonnée chemin du littoral ou sentier des douaniers.
· le petit pont génois
angebot bereit schnell
hallo,
ungl aublich, aber wahr, es gibt zu viele betrügereien über kreditangebot
Par Sabine, le 08.02.2022
comment ne pas aimer la corse !
Par Anonyme, le 20.07.2021
bonjour,
me rci pour ce relais...
nou s connaissons-no us peut-être?
bien à vous.
hugue s simard
Par Anonyme, le 03.05.2021
et comme toujours pas un mot sur la seule cause à la base de la catastrophe climatique : la surpopulation, jam
Par anonyme, le 22.04.2021
donat nonnotte; donatien nonnotte, né le 10 février 1708 à besançon et mort le 5 février 1785 à lyon, est un p
Par Anonyme, le 14.03.2021
air amis amour animaux background belle bleu bonjour bonne cadeau carte centre
Abonnement au blogImagesStatistiques
Date de création : 16.06.2010
Dernière mise à jour :
29.03.2023
1170 articles
COMME TOI.
Résumé
Une troublante impression de déjà-vu... Ellie a disparu à l'âge de quinze ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. Dix ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de neuf ans, le passé la rattrape brutalement : cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue...
...................................................................................................................................................................
Les jardins d'Eden
Résumé
Jip Sand est revenu de tout et surtout d'un sale cancer. Il est aussi revenu à Paradis, dans la ville et la maison de son enfance, pour se requinquer et retrouver sa fille, Annie dite Na, qui semble avoir disparu depuis plusieurs mois. Paradis, sa clinique privée, ses eaux thermales et ses Jardins d'Eden. Mais aussi Charapak, l'envers du décor, la casse des Manouches, et le corps à moitié dévoré de Manuella, l'amie de Na, retrouvé dans les bois quelques années plus tôt.
Ce que Jip n'a pas cherché à élucider à l'époque, il veut le comprendre aujourd'hui. Pour Na. Pour savoir ce qui lui est arrivé. Mais il y a des vérités plus mortelles que des-maladies...
...............................................................................................................................................................
Extrait;
1
L'été
Bien entendu tu es content d'être sorti du fracas. Sauf que tu en traînes toujours des lambeaux avec toi, que l'échappée prend son temps, la garce, qu'on dirait bien n'en avoir jamais vraiment fini avec elle, au fond.
La bécasse de l'accueil leva de ses mots fléchés un œil qu'elle figea sur lui, le laissant venir à elle dans l'entrebâillement de sa paupière, sans trembler d'un cil.
La porte à tambour antédiluvienne émettait toujours le même soupir hoquetant, au démarrage. Seuil franchi, il s'était retrouvé tout net une bonne poignée d'années en arrière. Coincé dans la grimace d'un autre présent.
— Salut, Jip, dit la bécasse.
Paulette. Pareille à elle-même, irrémédiablement inaltérée, femme tronc derrière son meuble, dans un de ses immuables pulls à col roulé plus ou moins lâches – seul accommodement aux saisons – qu'elle portait indifféremment par canicule et neige de décembre, clim ou pas clim. Et puis cette grimace traversière monomaniaque permanente qui donnait l'impression qu'elle soufflait à jet continu la fumée d'une cigarette par la commissure, que la cigarette coupable existât ou non. Un regard vaguement jauni et injecté sur les bords. Elle n'avait jamais été belle mais ne serait jamais moche.
— Alors t'es pas mort ? dit-elle avec ce qui devait être un clin d'œil et un sourire accompagnateur.
Sur un ton rauque aussi décharné que le fond de sa pensée enfouie.
— Tu vois, dit Jip.
Il eut un mouvement en avant, une esquisse, puis un recul aussi sec, du genre de quand on ne se souvient plus si on se fait la bise ou pas. Ça lui avait paru éventuellement possible une seconde. Une fraction.
Elle rafala, gueule en biais, du coin de sa lippe tordue qui souriait peut-être :
— Oui, je vois. T'as quand même une sale tête, si je peux me permettre, pas très vaillant, si ? T'es tiré d'affaire ? Je sais plus qui m'a parlé de toi, justement, il y a quelques jours, ou… je sais plus.
— Quelqu'un qui regrettait que je sois ?
Elle réfléchit d'un coup de sourcils froncés sous la marque du lion :
— Je peux pas dire… T'as pas changé, hein ? T'en es sorti mais t'es toujours dedans, on dirait.
Ce genre d'humour chevillé au corps et au cœur.
— Je peux le voir, le manitou ? s'enquit Jip.
Paulette accentua sa grimace en la tortillant latéralement, gauche / droite, un coup sec, et laissa tomber :
— Va savoir, mon beau.
— Savoir quoi ?
— S'il est là…
Jip s'appuya d'un coude au bois verni du comptoir, un sourcil connaisseur levé en arc de cercle, tirant de sa poche poitrine de blouson un paquet de cigarettes qui resta en suspens au bout du geste réprimé net par l'injonction de l'hôtesse-cerbère :
— On fume pas, ici, mon ami, t'as oublié ?
Tandis que pianotant sur les touches d'un clavier invisible sous l'avancée en pupitre de son cagibi, mâchouillant dans son micro-collier.
— C'est un revenant qui veut vous voir, boss.
Jip rempocha le paquet et nota incidemment le vouvoiement et le « boss » à l'américaine. C'était nouveau ?
— Sorry, miss, laissa-til tomber, dans le ton.
— Oui, oui, poursuivit Paulette dans sa pastille après un temps de silence suspendu. Oui… Non… Oui… Je sais pas. Oui. Oui. Oui. Non, non.
— Dis-lui que je viens en paix. Que j'agite un drapeau blanc.
Elle affûta comme jamais son regard professionnel traversant Jip qui ne présentait alors pas plus de consistance et d'opacité qu'une gelée de fromage de tête.
— Oui, oui. Non, non… Sand, c'est cela, oui, vous avez du flair, boss. Non, non. Oui.
Elle raccrocha d'un balayement de ses mains cachées et retira un des écouteurs de son oreille gauche, enfouie sous sa tignasse d'incendie.
— Quel drapeau blanc ? dit-elle.
— Oublie, ma grande.
Paulette ferma un œil et ce qui subsistait de son regard devint terriblement circonspect.
— Tu peux y aller, lâcha-telle comme une forme de long pet buccal.
— Parle-moi d'un flair, dit Jip en ressortant le paquet de Winston de sa poche. Je l'ai appelé il n'y a pas une heure…
— Ça m'étonnerait, mon gamin.
— Étonne-toi, belle enfant.
Il tourna les talons, s'éloigna de ce qu'ils appelaient, lui et quelques vieux de la vieille, la « caginotte » de l'accueil, planta une cigarette au coin de ses lèvres exsangues de convalescent.
Le hall embaumait la soupe de légumes, le velouté de pois cassés, allez savoir pourquoi. Ou bien était-ce une odeur trimballée depuis Dieu sait où et quand par les capteurs olfactifs de Jip Sand ? Allez savoir pourquoi. Allez savoir depuis quand, de quelle source enfouie au fond des labyrinthes blancs, sous les néons tranchés comme des coups de rasoir, dans les échos crépitants de cavalcades éternellement répétées…
La lumière jaunie papillonnait, tombée en virevoltes d'autres néons d'un autre âge. Il y avait sous l'unique fenêtre haute un banc de hêtre vieux à l'assise de cuir craquelé qui gardait l'empreinte en trois creux de tous les postérieurs qui avaient fait escale ici depuis sans doute un siècle, probablement à la création du journal, une sorte d'éternité, attendant leur tour de se lever dans un petit crissement du cuir définitivement toujours ancien. Pour l'heure, sur la banquette, une jeune personne en court short de jean et aux cuisses bronzées agréablement fuselées élargies dans leur épaisseur aux points de contact avec le siège, tongs, t-shirt flottant vaillamment échancré et rebondi de part et d'autre de la vallée, aux cheveux de cirage noir pratiquement ras, le nez plongé vers un iPhone sur lequel elle pianotait en virtuose des deux pouces. Au passage de Jip elle laissa glisser, détachée, sans lever les yeux de son concerto :
— J'en connais qui vont se faire engueuler.
Jip lui jeta une œillade, pour s'assurer qu'elle n'était pas de ses connaissances, ni anté ni postcataclysmique – en tout cas ne s'en souvenait pas, si l'éventualité d'un souvenir possible s'était posée.
— Pas de certitude hâtive, dit-il, je n'ai encore rien fait.
Elle leva vers lui un sourcil étonné à l'instant où il frappait deux coups brefs sur la pancarte GRAND EST - RÉDACTION collée au centre de la porte massive peinte en trompe-l'œil de chêne roux – d'un autre âge, comme tout le reste du monde, à l'exception de la gamine et du short de la gamine. Sans attendre quelque éventuelle invitation qui lui serait parvenue à travers l'huis à pousser la porte et entrer, il poussa la porte et entra.
La referma derrière lui.
La pièce n'était pas particulièrement vaste, les cinq ou six personnes qui l'occupaient, hommes et femmes apparemment à parts égales, donnaient pourtant, ou justement, l'impression d'être deux fois plus nombreux.
— Bonjour jeunes gens, jeta Jip.
Il se fit un temps de silence dans une ou deux conversations interrompues, sur tous les regards tournés vers lui, avant que les visages s'éclairent, que s'épanouissent (plus ou moins) quelques sourires. Pas une seule tête nouvelle, à première vue. Ni de changement notoire dans la distribution des bureaux et meubles, d'après ce qu'il s'en souvenait. « Wouah ! » s'exclama Clara, qui paraissait franchement contente en découvrant tout le panoramique de sa denture XXL, et se leva de son bureau et vint vers lui et dit : « Jip ! Eh ben alors ? » et lui posa d'autorité une bise sur chaque joue, et Jip dit : « Eh ben oui, ma grande ! » et il serra la main du gros J.P. GrandJean qui lui aussi s'était approché et glissa sous sa moustache de moustachu quelque chose comme : « Alors te v'là rev'nu, toi ? », et Jip dit : « Moi, oui » et il poursuivit son chemin par l'allée centrale qui séparait les box de verre jusqu'au fond, vers les verrières dépolies et la machine à café et Tourne-Cul qui se restaurait gaillardement de tranches de terrine aux trois poivres piquées de son Laguiole, debout devant et à même le frigo grand ouvert.
Le roquet Tourne-Cul. Il porta à sa bouche la becquée de terrine.
— Merde alors, mâchonna-til, je te croyais foutu ! Le revoilà !
— Mais je t'emmerde, mon petit bonhomme, lui sourit Jip. Ferme cette porte, tu vas te ramasser une pneumonie de couilles.
— Le grand con 2, le retour !
Une des filles dans la salle laissa fuser trois notes de rire.
— C'est ce qui m'a manqué le plus, dit Jip. Cette atmosphère de saine camaraderie…
Il frappa à la porte vitrée RÉDACTION, sous le nom de Tournon, et entra.
— … toutes espèces confondues.
Le gloussement grinçant de Tourne-Cul fiché dans une oreille le temps de refermer la porte.
Le rédac chef se tenait derrière son bureau, au centre de la petite pièce, dos à la fenêtre, entre un mur de classeurs en pagaille et un autre d'étagères surchargées de toutes sortes de tout, livres et paperasses, et un espace dépourvu de rayonnages tapissé de posters. Il faisait face à la porte. Vous attendait dans son fauteuil de président de quelque chose, comme prêt à bondir, coudes au bureau.
trois minutes, dit-il.
— Tourne-Cul me cherche. Alors que je suis pas là depuis trois minutes, comme je me disais. Bonjour monsieur le rédacteur.
— Salut Jip.
— En chef, dit Jip.
Il considéra le siège du visiteur face au bureau, s'appuya au dossier des deux mains et ils restèrent un moment plutôt long ainsi, à se regarder, face à face, Joël de Tournon et lui, Jean-Pierre Sand. Un regard partagé, sans animosité ni sympathie excessive.
Le massif accoudé sur le grand sous-main du bureau, dans sa chemise bleue tendue aux épaules, son petit gilet sans manches et la chaîne de montre début XXe qui lui barrait le haut du bide. Face au grand machin voûté pas plus épais qu'un coup de trique et que l'épreuve chirurgicale des derniers mois, avec son corollaire pathologique global, n'avait pas aidé au rebouchage des creux et excavations de sa silhouette, les yeux cernés de sombre, le cheveu définitivement et uniformément gris, la barbe de plusieurs jours, les dents encore en place laquées à la nicotine… Quelques secondes suffisantes pour comprendre que certainement le combat n'était pas, ne serait pas, équitable. Sans que les physiques opposés fussent seuls, dans l'affrontement, à marquer des points.
— Alors ? dit Jip. Je commence par où ?
— Comment tu vas ? renifla de Tournon, se redressant comme si ses avant-bras s'allongeaient, les muscles de ses épaules roulés en boule sous la chemise.
Jip hocha la tête de côté. Il retira du coin de ses lèvres la cigarette que la moue approbatrice avait fait tressauter, la tourna, la roula entre pouce et index à hauteur de son visage en la considérant d'un œil intéressé.
— Ça a failli, dit-il.
— Il me semble, oui. Tu as eu de la veine. On est contents pour toi.
— Sans blague.
— Évidemment, dit le rédacteur en chef. De la veine c'est pas peu dire. Faut quand même bien avouer que tu étais plutôt dans un sale… dans un mauvais état, en gros. Moi, quand on m'a dit, je te voyais pas sortir de là autrement que les pieds devant.
— Comme quoi, hein…
— Franchement, Jip. Tu peux pas m'en vouloir de te dire ça, de penser ça.
Jip faisait rouler la cigarette entre ses doigts.
— Mais je ne t'en veux pas, Joël. Évidemment, je ne t'en veux pas un poil. Je bois plus.
— Parfait, Jip.
— Plus une goutte.
— Parfait. Si tu le dis…
— Je le dis parce que c'est vrai. Parce que je pense que c'est vrai.
— Parfait, Jip. La plupart des gens ne reviennent pas de ce genre de kermesse. Tu le sais.
Kermesse…
— Beaucoup, oui, je sais. Mais pas la plupart. C'est dépassé, ce temps-là de la plupart. Beaucoup s'en sortent, maintenant, contrairement à ce qu'on croit. Ça dépend du secteur qui est atteint. Ils m'ont enlevé la bonne tranche. Les bons morceaux. Ça va.
De Tournon décolla ses coudes du bureau et poussa sur ses pieds et recula d'un bon mètre assis dans son fauteuil à roulettes.
— Quand même, dit-il avec une grimace de la lippe qui pouvait passer pour une manière de félicitations. T'as combien de pièces neuves, maintenant ?
Il indiqua d'un mouvement de menton la cigarette que Jip tenait entre deux doigts :
— Tu cherches à ce qu'ils te changent les poumons, aussi ?
Jip regarda la cigarette et la fit rouler un petit coup et la pinça entre ses lèvres.
— On fume pas dans les bureaux, dit de Tournon.
Jip dit (la cigarette tremblota au rythme des paroles) :
— Je suis en train de me demander si c'était pas une très mauvaise idée de venir ici. En fait je ne me demande même pas, je me réponds. On va laisser tomber, d'accord ? Désolé de t'avoir dérangé dans ton boulot harassant, Joël. Et bonjour chez toi quand tu y seras.
En vérité, il s'était demandé depuis le matin, et même depuis la veille et une partie de sa nuit d'insomnie, depuis qu'il avait eu cette idée et pris la décision de retourner au Grand Est, comment et par quel bout il allait aborder le sujet. Il avait mentalement esquissé plusieurs pistes, rejetées ou oubliées aussi vite qu'elles lui venaient, pour finalement se garder la disponibilité d'un grand vide… et en arriver là, en cet instant, à l'évidente certitude qu'il eût mieux fait de quitter la ville ce matin et filer en droite ligne jusqu'à Paradis et sa maison sans ce crochet finalement imbécile par le journal, dans cette autre ville qu'il avait mis plusieurs dizaines d'années à méticuleusement détester. Et revoir toutes ces têtes comme autant de boulets attachés aux fers de souvenirs qui baignaient uniformément dans une mer de fiel.
Conneries. Qu'est-ce que tu attends, Jip, malheureux ?
— Te fous pas de moi, Jip, grinça le rédac chef, renversé dans son fauteuil, mains croisées sur son bide et jouant de deux doigts avec une chevalière mastoc passée à l'annulaire droit. Accouche donc.
arier sur pourquoi t'es là.
— Tu paries ?
— C'est non, Jip.
— Vous avez laissé tomber, c'est ça ? Affaire classée, bien entendu.
— Et pourquoi, « bien entendu » ? grinça de Tournon.
Il se leva brusquement, voire violemment. Son fauteuil roula derrière lui jusqu'au radiateur bas en fonte, sous la fenêtre. Immense et massif. Un frisson traversa Jip de haut en bas, au souvenir soudain de cette empoignade, jadis, à l'autre bout du temps, qu'il avait généreusement provoquée et dont il était sorti dessoulé net, la tête vrombissante et la prothèse dentaire voilée…
— Il y a eu enquête, et si tu veux savoir, rien ne permet de dire que l'affaire est classée, comme tu le supposes, si toutefois « affaire » il y a, et je ne vois pas laquelle. On a retrouvé cette gosse dans les ronces des forêts pourries de ton bled de sauvages, dans l'état que tu sais, victime d'on ne saura jamais qui, probablement d'un ou plusieurs de ces tordus qui hantent ces contrées, ces trous du cul du monde civilisé dont tu es un produit représentatif échappé. Ne recommence pas, Jip. Ne reviens pas me faire chier avec ça, à peine ressuscité des morts-vivants. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, pas vrai ?
— Je mentirais si je prétendais le contraire.
Jip remit la cigarette entre ses lèvres, tira un Zippo de sa poche et en fit claquer le couvercle et porta la flamme à hauteur de la Winston et tira une bouffée.
— Sors d'ici, Jip.
— D'accord. J'en conclus que non, alors.
— Je t'ai foutu à la porte une fois, Jip. Ou bien tu es parti sans qu'on te pousse, je sais même plus, tu as osé te repointer en prétendant à une retraite ou des indemnités, on n'a jamais réglé ce problème, si c'en est un. T'es revenu une ou deux fois faire du scandale en gueulant des menaces et suant le pinard. C'était plus facile de discuter avec un de ces chiens bâtards borgnes de tes Hauts qu'avec toi. C'est toi, en plus, qui as fini par nous envoyer paître en nous annonçant que tu passais au niveau supérieur, au Hauts de France, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On a vu quoi ? À part que déjà tu roulais plus dans les rails. Que ça commençait à urger, qu'on t'interne.
Jip souffla un mince filet de fumée.
— On m'a pas interné. Je suis tombé malade, nuance. Et pas qu'un peu.
— On t'a vu prendre un abonnement à l'hosto, voilà ce qu'on a vu. Aux frais du contribuable et de la sécu, comme c'est la règle avec les taches dans ton genre. Et putain, ils se sont débrouillés pour te sauver la vie ! Et deux fois de suite, en plus ! On aurait pu être tranquilles, mais non. Et puis tu reviens dans mes pattes et tu remets ça, à peine vertical ? Et je ne sais même pas pourquoi je discute avec toi, parce que le vertical c'était pas le plus important à rectifier.
De Tournon fit le tour du bureau et avança vers Jip, le bras tendu, le doigt pointé vers la porte. Il s'arrêta à trois pas. Attendit, le regard noir étrangement posé.
— Dans tous mes scénarios, quand j'imaginais le moment, j'avais pas prévu que tu perdrais tes boulons à ce point, dit Jip.
De Tournon hoqueta.
— Parce que c'est moi qui perds mes boulons… Tu veux une baffe, maintenant, pour te faire décoller plus vite ?
— Et tu sais ce que ça te coûterait, de porter la main sur un convalescent double handicapé ? Je suis pas saoul pour la moitié d'un rond, je bois plus, je suis en train de me refaire une santé, aussi bien physique que mentale, comme t'as l'air d'en douter, avec tes insinuations. Je sais à peine de quoi tu parles quand tu me dévides ce chapelet d'accusations calomnieuses. Tu sais ce que ça coûterait si je portais plainte ? Cinq ans, 50 000 balles… Je venais juste te demander de reprendre mon boulot. Parce que je peux le faire, j'en suis capable.
— Ah oui ? Et tu ne travailles plus pour les autres des Hauts ? Comment ça se fait ? Dégage, Jip. Allez. Ne m'énerve pas.
— Y a personne au monde de moins énervant que moi, en ce moment et dans ton foutu bureau de rédacteur en chef, chef.
— Dégage, Jip, ou ça va finir dans les dérapages incontrôlés.
De Tournon baissa le bras mais fit un autre pas. Il avait une respiration de buffle. Une haleine assortie. La fumée de la cigarette de Jip voleta dans une autre direction sous le courant de son souffle.
— D'accord, chef. Je prends note.
— Dégage.
— Je prends note. Mais c'est con pour toi, Joël. Tu passes à côté de quelque chose, dit Jip.
Il étouffa un hoquet de toux derrière sa main et recula vers la porte.
Quelquefois, tu vois, tu en arrives à te dire que c'était mieux quand tu étais mort. Au moins, déjà, tu ne te souviens pas, et quand d'aventure tu te retrouves pour une pause au bord du chemin, tu peux toujours douter, ne pas te faire confiance à la lettre, estimer que ce n'est probablement pas véritablement toi.
....................................................;
2
Et quand tu en es arrivé là, tu penses très fort : qu'ils aillent tous se faire foutre. Le plus fort possible. Dents serrées. Et tu te dis que plus tu le penseras fort, plus il y aura de chances que le vœu se réalise. Que sur un putain de coup de putain de baguette magique ça devienne la réalité. Comme dans ces livres d'histoires pour les petits, dont il faut colorier les illustrations « sans dépasser les bords », ce genre de livre que Na prenait un malin plaisir à torcher n'importe comment, dans tous les sens, et qu'une fois son forfait accompli elle soumettait à votre jugement avec, déjà, ce sourire arrogant qu'elle avait su grappiller aux lèvres de sa mère.
Sauf que ça ne marche jamais comme dans les histoires éclaboussées de couleurs confondues.
Ils ne se font jamais foutre et au bout du compte c'est toi qui te ramasses le retour de flamme. Ma parole.
C'était un pays en longueur, d'une certaine façon, dessinant, avec ses deux vallées que séparait un embrouillamini confus de collines et de coteaux boisés et de tertres broussailleux, une sorte de fourche à deux dents.
Un pays sur lequel était tombée au hasard du bord du monde, à une époque enfouie, une pluie de noms bizarres, qualifiés de propres, pas vraiment faits pour l'endroit, patronymes plutôt mal assortis, ne fût-ce que, pour commencer : Paradis – tel un couvre-chef pour le moins cocasse affublant le village.
Paradis…
Mais non seulement.
La vallée majeure, qui suivait l'ample courbe de la rivière sur les rives de laquelle s'éparpillaient la plupart des foyers de l'agglomération, de part et d'autre du tracé de la route déroulée jumelant le cours d'eau, s'énonçait « vallée de la rivière ».
L'autre dent de la fourche – une entaille mal fichue d'une demi-douzaine de kilomètres qui finissait en cul-de-sac marécageux et hérissé d'un étonnant fouillis de halliers, traversé par les méandres incertains d'un bras jumeau de la rivière que des pointilleux, se fondant sur son débit moyen au fil des saisons, prétendaient être le cours principal – avait été baptisée « Charapak », depuis (et forcément avant) la première nomination du lieu sur une carte, au XVe siècle, et les historiens géographes amateurs ou professionnels qui s'étaient penchés sur l'origine de ce nom, qui l'avaient abreuvé de savantes interprétations étymologiques assaisonnées de grec, de latin, d'ancien et moyen français, plus quelques ébouriffements patois de toutes les vallées à cent lieues à la ronde, ne se comptaient plus. Des farfelus sans peur ni reproche allaient même jusqu'à référencer une troupe d'Iroquoiens du Nouveau Monde tombés là au fil de Dieu sait quelles avanies et qui auraient sévi dans les bois un temps avant de se faire chasser et décimer par des autochtones encore plus ombrageux qu'eux – le mystère de leur apparition comme celui de leur disparition demeuraient, mais on aimait croire à leur histoire. Charapak.
En vérité, Charapak, dont on n'apercevait rien depuis la grande vallée de la rivière que la barre d'éminences et tertres forestiers, caché scrupuleusement aux regards, dont on n'aurait au grand jamais soupçonné l'existence, n'eût été le panneau signalisateur, là-bas, à l'entrée du bourg, sous ses dehors d'enclave en retrait, se trouvait être paradoxalement sans doute mais bel et bien le cœur battant du village, des plus bouillonnants et sanguins qui soient. L'âme du lieu – pourrait-on dire aussi… Une âme pour le moins mécréante, dans le plus haut de ses palpitations, mais disons-le…
Charapak avait vu s'implanter dans ses heures de gloire et sur le flanc droit de son goulet, en bordure de l'Agnelle, les tissages et filatures Floriot, au mitan du XIXe siècle, dont ne subsistait plus désormais que la friche industrielle, hauts murs gris galeux, innombrables fenêtres noires aux carreaux brisés, toiture en dents de scie, vertigineuse cheminée de briques rousses, après quelques tentatives de reprises et installations diverses suivant le silence des Sulzer. Les cités ouvrières qui avaient abrité les troupeaux successifs des familles de tisserands ayant vécu du coton, leurs enfants et petits-enfants après eux, étaient toujours debout, comme une garde montée inébranlable de part et d'autre de la route et de la rivière, à la fourche ouverte des deux vallées presque jumelles. Elles avaient toutes été rachetées par la descendance torrentueuse ouvrière reconvertie en d'autres formes soft d'esclavages dégagées, certes, dans leur modernité, des lourdes ombres de l'ancestral paternalisme. Les gens travaillaient ailleurs, plus souvent dans d'autres vallées, d'autres villes, de ce côté-ci des montagnes ou de ce côté-là.
D'autres ruines, dressées, avant que d'en être devenues, sur l'époque de ses splendeurs, surplombaient le flanc nord de Charapak, pareillement à l'abandon depuis des lustres : les vestiges des établissements thermaux surgis de la montagne, à la suite de certaines sources capturées et exploitées dès lbienfaits radioactifs de leurs eaux bicarbonatées, arsenicales, ferrugineuses et gazeuses ».
C'était de notoriété qu'en d'autres belles époques Marie Duplessis comme Sarah Newton en avaient été buveuses, sur recommandations médicales… On continuait de s'en faire une gloire parmi ceux qui connaissaient l'Histoire et rêvaient, pourquoi pas, d'une réhabilitation de l'endroit dans ce sens-là, conservant pieusement articles de presse, photos et publicités de ces temps effacés, continuant d'entretenir dans un minimum de toilettage les quatre sources disséminées sur les pentes montagneuses, aux filets desquelles les vaches de jadis, les vraies découvreuses, avaient préféré boire plutôt que laper au cours de la rivière. Les Eaux de Paradis.
Qui sait, les gens qui réagissent par la défensive aux traits d'une fanfaronnade jugée un peu trop appuyée n'avaient-ils pas apprécié cette raison sociale publicitaire à la définition pourtant on ne peut plus limpide, dans tous les sens du terme.
L'opération commerciale n'avait pas donné les résultats escomptés, au reproche principal que les fameuses eaux ne tenaient pas leurs promesses, menteuses, et que leurs vertus proclamées s'effondraient sur elles-mêmes et ne résistaient pas à l'incarcération de la mise en bouteilles. Le groupe de ces bâtiments-là émergeait toujours des hauteurs bouclant le cul-de-sac, le temps et l'abandon semblaient sans véritable emprise sur les murs couverts de lierre, les toitures de tuiles céramiques colorées parfaitement inhabituelles pour la région, les hautes fenêtres aux volets clos que personne n'avait jamais eu l'idée de venir briser ou voler, les mosaïques des anciennes salles de cure que personne n'avait descellées et sur les paysages fanés desquelles des vagabonds de passage, des ivrognes en goguette, des jeunes en apprentissage de bringues sauvages s'étaient contentés de signer leur présence d'étrons quasiment rituels, pratiquement dépourvus de conviction, qui séchaient sans odeur et finissaient par disparaître dans les entrailles de saisons fraîches, au fil des brouillards fouineurs.
Bien sûr les rangées de robinets alignés au-dessus des vasques turquoise avaient été dévastées : le respect des vieilles pierres ne s'érige pas sans un minimum, une once de vandalisme.
On disait toujours les maisons des Eaux.
D'aucuns tels que les célèbres jumeaux Touetti des Jardins d'Éden prétendaient remettre l'antique thermalisme en fonction. Ils n'étaient pas les seuls, Titi Angolf le premier – en l'occurrence le second. Et même on avait vu en surgir d'autres, venus d'ailleurs, pour ne pas dire de nulle part.
Mais Charapak n'eût pas été totalement Charapak sans le camping, ses bungalows forestiers attenants et le Château en fond de val, gardien de pierres à tourelle rococo et toiture d'ardoises grises.
Puis – au-delà d'une frontière enfouie sans autre marquage particulier que cette lourdeur soudaine qui vous pesait aux épaules, et comme si un souffle accompagnateur humide s'élevait de quelque part, un courant d'air cardé en soupir, franchie quelque limite suspendue dans les feuilles et le pas devenu bizarrement silencieux sur la terre battue du sentier balayé de toute pierre –, dans la clairière enfouie au cœur des profondeurs, en bout du long couloir étroit de Charapak : le campement, le casse, le bas hameau.
La verrue. Ou la plaie.
L'autre monde.
L'automne, avant
C'était la première fois que Jip revenait à la maison en compagnie de Céline – il en était à peu près certain, il avait fallu qu'il se brasse la tête pour s'en persuader : c'était un peu la pagaille, aux étages, dans ses neurones, depuis quelque temps – non seulement un peu mais de plus en plus. Et pas que la faute à l'alcool.
L'automne prenait une drôle de tournure, en ville, là-haut, comme ici, apparemment. L'été avait été intégralement pourri, le mois d'août particulièrement. Les jours avaient commencé de s'ébrouer et retrouvé une forme séante de vie ensoleillée en septembre. Progressivement. Et puis ça s'était emballé (la « drôle de tournure »), avait pris de la vitesse, jusqu'au déraillement complet. À quelques portées de soirs d'octobre, la région tout entière crevait de chaud jour et nuit, sous les effets d'une espèce de canicule retardataire bricolée à la va-vite.
Il n'était pas 18 heures et le ciel posé en équilibre menaçant sur les montagnes était d'un bleu noirci plus opaque et dangereux qu'une véritable couverture nocturne. Des fissures mouvantes palpitaient sur les horizons bossués du sud-est, comme des fractures de reflets qui roulaient et s'enchevêtraient dans la masse des remous. La sombreur était graduellement montée des crêtes et s'était répandue, avait envahi, dans un silence de plus en plus assourdi qui avait aplati tous les autres bruissements de cette mue d'été défroqué. Même les crissements d'insectes levés des prés bordant la route, et que l'on pouvait ordinairement percevoir par la vitre baissée de la portière, s'étaient trouvés effacés.
Il y avait peu de circulation. Le paysage semblait désert, les gens fort peu nombreux, sur les trottoirs ou devant les portes des maisons,
dans les rues des villages traversés, comme si la menace céleste avait fait fuir les populaces et les individus.
À l'entrée de Paradis, sous le panneau indicateur, ils virent un chien blanc et noir frisé assis sur le rebord du fossé, visiblement sans collier ni personne qui l'eût accompagné à plusieurs dizaines de mètres à la ronde, et Céline dit : Ce chien va se faire écraser. Quel chien ? demanda Jip dans un sursaut qui l'extirpa une fraction de seconde de sa somnolence. Ce chien au bord de la route, dit Céline, et Jip dit : J'ai pas vu de chien, où ça, le chien ? et Céline ne répondit pas. C'étaient les premiers mots qu'ils échangeaient depuis plus d'une heure, depuis leur départ de la Ville, ceux qu'ils n'avaient pas échangés cent, mille fois plus nombreux et pesants. À présent, depuis quelques instants, des éclairs furtifs éclaboussaient de zébrures étouffées le ventre bourrelé des nuées.
Céline conduisait une main sur le haut du volant, l'autre coude à la portière. Le courant d'air faisait danser les boucles sur son front et les mèches de la courte queue-de-cheval qu'elle s'était nouée à la va-vite, sans être parvenue à sécher totalement l'emperlée de sueur dorée dans le creux de son cou. Les verres des lunettes de soleil lui mangeaient presque entièrement le haut du visage, laissant pointer entre eux l'extrémité d'un nez verni en coup de soleil rouge.
Jip tira une cigarette d'un paquet cartonné dans la poche poitrine de son blouson et la fit rouler entre pouce et index.
— J'aurais pu conduire, dit-il. On arrive.
— Sûr, dit Céline. Je vais où, maintenant ?
Jip dit qu'il allait prendre le volant et ils s'arrêtèrent au premier accotement venu qui leur permettait la manœuvre, avant le pont jeté sur la rivière et le panneau de signalisation en ciment à l'entrée sud de Paradis, et Jip descendit de voiture et déplia son long corps maigre et s'étira en faisant des bruits de gorge et ils échangèrent leur place dans la voiture et Jip dit « Allez, tu vas voir ça ! » puis il parut se souvenir de la réelle raison de sa présence ici et son visage pâle dans la lumière plombée se ternit en même temps qu'une grimace contrariée s'y inscrivait.
Il redémarra un peu rudement et ils se retrouvèrent derrière un transporteur de bouteilles de gaz qu'ils suivirent, au pas, durant toute la traversée du village, tandis que Jip râlait contre les émanations d'échappement. À la sortie en direction du col, ils laissèrent filer le camion puant et prirent à gauche la route plus étroite qui s'engageait dans la vallée voisine de Charapak.
Le ciel avait maintenant des teintes de gouffre suspendu à la renverse au-dessus des têtes, avec des moirures de bronze verdâtres dans l'énorme cavalcade ralentie, d'une pesanteur sans pareille que l'on sentait prête à crever à tout instant.
Jip, dents serrées, sa cigarette non allumée tressautant au coin des lèvres à chaque crispation des mâchoires. Le regard fixe.
Céline, qui n'était venue là qu'une fois, pour l'enterrement, des années auparavant et alors qu'elle ne connaissait pas vraiment, ou à peine, Jip, qui probablement, et qui, à sa mine, ne se souvenait plus des lieux, ouvrait de grands yeux derrière ses lunettes de soleil noires.
Le tunnel devant eux ouvert sur Charapak entre les arbres bordant la route était d'une noirceur absolue, comme tranché sur la nuit descendue d'un coup juste là, alors que le véritable soir se traînait encore loin derrière. De la sueur perlait au front de Jip, coulait dans ses yeux qu'il clignait régulièrement, avec force grimaces, pour chasser les gouttelettes chatouilleuses.
Ils longèrent l'alignement des anciennes cités ouvrières attachées au tissage de Charapak. Des gens devant certaines des maisons, des hommes en t-shirts colorés ou blanc éblouissant dans la mauvaise pénombre dégringolée s'immobilisèrent dans leurs occupations pour regarder passer la voiture rouge. Des enfants à moitié nus sur des vélos hystériques bondissants jouaient entre les maisons dans des nuages ras de poussière.
Laissèrent sur leur droite les anciens bâtiments et la haute cheminée des tissages fantômes. Puis Jip marmonna ce qui semblait un « Voilà » dans un soupir râpeux du fond de la gorge et tout en allumant ses phares, traversant la route, et la maison apparut, en bout d'une contre-allée derrière la haie de hêtres, lactescente, éblouissante, dans l'orbe double de lumière.
................................................................................................................................................................
Bio:
Pierre Pelot, de son vrai nom Pierre Grosdemange, né le 13 novembre 1945 à Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges, est un écrivain français. Il est extrêmement prolifique, on lui attribue près de 200 titres. Il écrit également sous les pseudonymes de Pierre Suragne (pseudonyme imposé par le Fleuve noir de 1972 à 1980) et Pierre Carbonari (seulement pour quelques nouvelles).
Œuvres
Romans de science-fiction
Une autre terre Coll. "Jeunesse Poche-Anticipation n° 18", Ėd. de l'Amitié, Ill. Claude Auclair, 1972.
L'Île aux enragés Coll. "Jeunesse Poche-Anticipation n° 28", Éd. de l'Amitié, Ill. Claude Auclair, 1973. (Suite de Une autre terre)
Les Légendes de terre Coll. "Olympic"", Ėditions G.P., Ill. Jean Retailleau, 1973.
Le Pays des rivières sans nom Coll. Spirale, Ėditions G.P., Ill. Jacques Pecnard, 1973.
Les Barreaux de l'Eden J'ai Lu n° 728, Ill. Wojtek Siudmak, 1977.
Fœtus-Party Coll. Présence du futur n° 225, Denoël, Ill. Stéphane Dumont, 1977.
Le Sourire des crabes Coll. "Science-Fiction n° 5003", Presses-Pocket, Ill.Wojtek Siudmak, 1977.
Transit Coll. "Ailleurs et Demain", Robert Laffont, 1977.
Delirium Circus J'ai Lu n° 773, Ill. Tibor Csernus, 1977.
Canyon Street Coll. Présence du futur n° 265, Denoël, Ill. Stéphane Dumont, 1978.
Le Sommeil du chien Coll. "Ici & Maintenant"", Kesselring, 1978. Nouvelle édition : "Science-fiction" n° 5166, Presses-Pocket, Ill. Wojtek Siudmak, 1983.
La Rage dans le troupeau Coll. "Science-Fiction n° 5060", Presses-Pocket, Ill.Wojtek Siudmak, 1979.
La Guerre olympique Coll. Présence du futur n° 297, Denoël, Ill. Stéphane Dumont, 1980. Réimpressions : 1994 (Ill. Michel Borderie et 1999 (Ill.Caza).
Parabellum tango J'ai Lu n° 1048, Ill. Caza, 1980.
Le Ciel bleu d'Irockee Coll. "Science-Fiction n° 5072", Presses-Pocket, Ill.Wojtek Siudmak, 1980.
Kid Jésus J'ai Lu n° 1140, Ill. Caza, 1980.
Les Îles du vacarme Coll. "Science-Fiction n° 5096", Presses-Pocket, Ill.Wojtek Siudmak, 1981.
Les Pieds dans la tête Coll. "Dimensions SF.", Calmann-Lévy, 1982.
Nos armes sont de miel, (éd. J'ai lu n° 1305, 1982, no 1305 (ISBN 9782277213055))
Mourir au hasard Coll. Présence du futur n° 339, Denoël, Ill. Stéphane Dumont, 1982.
La Foudre au ralenti J'ai Lu n° 1564, Ill. Boris, 1983.
Fou dans la tête de Nazi Jones, Belladone et compagnie, Coll. Anticipation, Fleuve noir, 1986.
La Nuit du Sagittaire Coll. "Science-Fiction n° 5338", Presses-Pocket, Ill.Wojtek Siudmak, 1990.
Messager des tempêtes lointaines Coll. Présence du futur n° 566, Denoël, Ill. Caza, 1996.
Romans fantastiques
Blues pour Julie Coll. "Espaces Mondes"", éd. Ponte Mirone, 1980.
Une jeune fille au sourire fragile Coll. "Science-Fiction n° 6", éd. Patrick Siry, 1988.
Une autre saison comme le printemps Coll. "Présences", Denoël, 1994 ; réédition Héloïse d'Ormesson, 2016.
La Fille de la Hache-Croix Coll. "Les Fantastiques", Magnard Jeunesse, 1998. Ill.
Mystère
Le Chant de l’homme mort, Mathieu Garden, Tome 1, Fleuve noir, 1995
Les Pirates du Graal, Mathieu Garden, Tome 2, Fleuve Noir, 1998
Policiers, romans noirs, thrillers...
La Forêt muette Coll. "Sanguine", Albin Michel, 1982.
Pauvres zhéros Coll "Engrenage", Fleuve noir, 1982. (Adaptation et dessins de Baru pour une bande dessinée parue chez Casterman et Payot/Rivages en 2008)
La Nuit sur terre Coll "Sueurs froides", Denoël, 1983.
Le Cri du prisonnier Coll "Engrenage", Fleuve noir, 1983.
Noires racines Coll "Sueurs froides", Denoël, 1985.
Roman toc, Fleuve Noir, coll. Spécial Police n° 1952, 1985.
L'Heure d'hiver, Fleuve Noir, coll. Spécial Police n° 1956, 1985.
Le méchant qui danse, Fleuve Noir, coll. Spécial Police n° 1964, 1985.
Natural killer Vertiges Publications, 1985. (Nouvelle édition revue : "Rivages-noir", Rivages, 2000.)
Le Bonheur des sardines Coll "Sueurs froides", Denoël, 1993.
Purgatoire Fleuve noir, 1986, coll. Gore n° 34.
Aux chiens écrasés Fleuve noir, coll. Gore n° 59. 1986.
Le Jour de l'enfant tueur, Coll. Points n° 653, Seuil, 1999. (Le Livre de Ahorn-1) (Préhistoire)
L'Ombre de la louve, Coll. Points n° 718, Seuil, 2000. (Le Livre de Ahorn-2) (Préhistoire)
Les Chiens qui traversent la nuit "Rivages/Noir", Rivages, 2003.
Les Jardins d'Eden Gallimard, Série noire, 2021.
Romans de littérature générale
Elle qui ne sait pas dire je Éditions Plon, Ill. Jérôme Lo Monaco, 1987. (Nouvelle édition revue : Éd. Héloïse d'Ormesson. 2014)
Si loin de Caïn Coll. "Rue Racine", Flammarion, 1988.
Ce soir, les souris sont bleues Éditions Denoël, Ill. Mark Rothko, 1993.
Les Caïmans sont des gens comme les autres Éditions Denoël, 1996.
C' est ainsi que les hommes vivent Éditions Denoël, 2003. Nouvelle édition, avec une préface de Jean-Christophe Rufin : Presses de la Cité, collection Terres de France, 2016.
Méchamment dimanche Éd. Héloïse d'Ormesson 2005
L'Ombre des voyageuses Éd. Héloïse d'Ormesson. 2006)
Les Normales saisonnières Éd. Héloïse d'Ormesson. 2007
L'Île au trésor, Coll. "Interstices", Calmann-Lévy, 2008.
Les Promeneuses sur le bord du chemin Éd. Phébus. 2009)
La Montagne des bœufs sauvages Éditions Hoëbeke, 2010.
L'Ange étrange et Marie McDo (éd. Fayard, 2010)
Maria (éd. Héloïse d'Ormesson, 2011)
Givre noir éd. la branche/Vendredi 13, 2012 (prépublication dans Télérama, juin à août 2009)
Petit éloge des saisons Éditions Françoise Bourin, 2013.
La Ville où les morts dansent toute leur vie Librairie Arthème Fayard, Ill. Manu Larcenet, 2013.
Debout dans le tonnerre, Éd. Héloïse d'Ormesson,2017.
Braves gens du Purgatoire Éd. Héloïse d'Ormesson, 2019.
Romans adaptés à la télévision et au cinéma
Les Étoiles ensevelies Coll. "Bibliothèque de l'Amitié", Éd. de l'Amitié-G.T. Rageot, 1972. (Téléfilm de Pierre Cardinal et Michèle Tournier diffusé sur la 1re chaîne française le 26 décembre 1974. Musique de Paco Ibanez)
Le Pain perdu Coll. "Grand Angle", Éditions G.P., 1974. (Téléfilm de Pierre Cardinal diffusé sur la 1re chaîne française le 30 mars 1977. Musique de Jacques Loussier)
Le Pantin immobile Coll. "Les Chemins de l'amitié n° 18, Éd. de l'Amitié-G.T. Rageot, 1976. (Téléfilm de Michel Guillet diffusé sur FR3 le 22 mai 1985.)
Fou comme l'oiseau Coll. "Les Chemins de l'amitié" n° 32, Éd. de l'Amitié-G.T. Rageot, 1980. (Téléfilm de Fabrice Cazeneuve diffusé sur antenne 2 le 22 juin 1983. Musique de Michel Portal).
L'Été en pente douce Yverdon (Suisse) : Kesselring, 1980. (Film de Gérard Krawczyk, 1987).
Récits et contes pour enfants
Les Aventures de Victor Piquelune - Amitié, 1977. - (Ma première amitié) Couv. et ill. d’Arnaud Laval.
Un Bus capricieux - Amitié, 1981. - (Ma première amitié ; 29) Ill. de Claire Nadaud.
Vincent, le chien terriblement jaune Illustrations de Dylan Pelot - Pocket, 1995. - (Kid pocket, Les grandes histoires de la vie ; J 151)
Vincent en hiver Illustrations de Dylan Pelot. - Pocket, 2000. - (Kid pocket, Les grandes histoires de la vie ; J 549)
Vincent et le canard à trois pattes Illustrations de Dylan Pelot. - Pocket, 2001. - (Kid pocket, Les grandes histoires de la vie ; J 666)
Vincent et les évadés du Zoo Illustrations de Dylan Pelot. - Pocket, 2002. - (Kid pocket, Les grandes histoires de la vie)
Vincent au cirque Illustrations de Dylan Pelot. – Pocket jeunesse, 2003. - (Kid pocket ; 1198)
Nouvelles
Sous le pseudonyme de Pierre Carbonari
Le Grand suicide, Périodique L'Impossible n° 6, décembre 1971.
L'Homme nostalgique, Périodique L'Impossible" n °7, janvier 1972.
Le Trait de génie, Périodique L'Impossible n+ 12, juin 1972.
Sous le pseudonyme de Pierre Suragne
Le Raconteur, revue de S-F Fiction n° 244, Opta, avril 1974.
Numéro sans filet, revue de S-F Fiction, n° 245, Opta, mai 1974.
Je suis la guerre, revue de S-F Fiction, n° 247, Opta, juillet 1974.
L'Assassin de Dieu, revue de S-F Fiction, n° 251, Opta, novembre 1974.
Ici, revue belge de S-F Argon, Opta, avril 1975.
Danger, ne lisez pas !, Les soleils d'Arcadie, anthologie de Daniel Walter, Opta, mai 1975.
Sables..., sables..., Dédale-1, anthologie de Henry-Luc Planchat, Marabout, 1975.
Sélection de nouvelles signées Pierre Pelot
Pionniers, Univers 06, anthologie de Yves Frémion, J'ai Lu, Opta, 1976.
Razzia de printemps, revue S-F Piranha, n° 2, Pierre de Lune, 1977.
Il y eut, ce soir-là, un orage, Planète socialiste, anthologie de Michel Jeury, Kesselring, 1977.
Un amour de vacances (avec le clair de lune, les violons, tout le bordel en somme), Retour à la terre n° 3. anthologie de Jean-Pierre Andrevon, Présence du futur, Denoël, 1977.
Nouveau-nés, Alerte ! n° 1, anthologie de Bernard Blanc, Kesselring, 1977.
Mauvaise passe, Quatre milliards de soldats Collectif n° 3, anthologie de Bernard Blanc, Kesselring, 1977.
Le Test, Alerte ! n° 3, anthologie de Bernard Blanc, Kesselring, 1978.
Bulle de savon, Pardonnez-nous vos enfances, Anthologie de Denis Guiot, Présence du futur, Denoël, 1978.
L'Amidéal, revue de S-F Fiction n° 292, Opta, juillet-août 1978.
L'Assassin de Dieu, Recueil de dix nouvelles publié sous la direction de Claude Ecken, Encrage Destination Crépuscule, 1998.
Le Long Voyage de Soleil-Fleur et Griffue Fantasy : Dix-huit grands récits de merveilleux, anthologie de Henri Loevenbruck & Alain Névant, Fleuve noir, 1998
Ecrire un commentaire
J'aime2
Trinichellu ,pour un trajet plein d' imprévus magiques.
Restonica Valley ,la plus féroce et magique.

La corse beauté Sauvage....
CALVI ON THE ROCKS
San Antoninu
Reines de sang!!
Grand Prix du Roman Historique 2020
Résumé:
« Il semble que je vivrai et mourrai en prison pour avoir commis le crime de me marier avec mon amant, seulement parce qu’Elisabeth n’a pas pu épouser le sien. C’est le degré ultime de la jalousie. Qui amène à un destin funeste. Et je crains de ne trouver la délivrance que dans l’au-delà. Digne de ses aïeux, elle invoque la mort partout où elle passe. Sa sœur a tué ma sœur. Elle mettra fin à mes jours. Cela ne peut se terminer que dans la mort : la mienne ou la sienne. »
Jane, Catherine et Mary Grey sont trois sœurs qui ne souhaitent rien d’autre que profiter des beautés de ce monde, de leur jeunesse, et de trouver l’amour. Mais leur héritage royal fait d’elles des cibles aux yeux de leurs cousines : Marie et Élisabeth qui se partageront successivement la couronne d’Angleterre et redoutent plus que tout de la perdre. Chacune d’entre elles est cependant déterminée à prendre les rênes de leur propre destin pour être la dernière Tudor même si cela signifie risquer sa vie et vivre ses derniers instants à la Tour de Londres. Dans ce jeu de pouvoir, qui sera la dernière Tudor ?
Cinq héritières présomptives, cinq femmes pour perpétuer la lignée des Tudor.
Une lutte de pouvoir sans merci.
............................................................................................................................................................
Extraits;
LIVRE I
Jane
Printemps 1550,
Bradgate House, Groby, Leicestershire
J’aime mon père car je sais qu’il est éternel, tout comme je le suis. Nous avons été choisis par le Seigneur et nous suivons Ses voies sans jamais nous en détourner. Nous ne cherchons pas à amadouer Dieu par quelque acte pieux ni quelque messe dans l’espoir de gagner notre place au paradis. Nous ne mangeons pas de pain en prétendant qu’il s’agit de chair, ni ne buvons du vin qui serait du sang. Nous savons pertinemment qu’il ne s’agit que d’un mensonge destiné aux ignorants, et d’un piège pour les sots au service du pape. Nous brandissons fièrement cette vérité et nous sommes toujours plus nombreux à savoir que nous avons déjà tous été sauvés. Nous n’avons pas peur, car nous vivrons l’éternité.
Certes, père se complaît dans ce monde matériel, ce qui est un péché. J’aurais souhaité qu’il me laisse lui ouvrir les yeux sur cette offense, mais il me rit au nez et s’exclame : « Laisse-moi, Jane. Va donc écrire une lettre à nos amis les réformateurs suisses. Je leur en dois une depuis trop longtemps. Tu n’as qu’à l’écrire pour moi. »
Il ne devrait pas éviter le débat théologique, mais sa seule faute est d’être trop distrait. Je sais que son âme et son cœur tout entiers sont au service de la véritable religion. Je ne dois pas non plus oublier qu’il est mon père, et que je dois obéissance à mes parents, quelle que soit mon opinion d’eux. Seul le Seigneur, qui voit tout, pourra les juger. D’ailleurs, Dieu a vu mon père et a choisi de lui pardonner ; mon père a été sauvé par sa foi.
Je crains cependant que ma mère ne puisse pas échapper aux flammes de l’enfer, et ma sœur Catherine, qui est de trois ans ma cadette et n’a que neuf ans, ne découvrira sans doute jamais rien de bon après la mort. Elle est incroyablement nigaude. Si j’étais suffisamment sotte pour croire en de telles inepties, je penserais même qu’elle est habitée par le Malin. Elle est une cause perdue. Ma plus jeune sœur, Mary, a été touchée par le péché originel et semble ne pas pouvoir s’en dépêtrer. Elle demeure étrangement petite. Elle ressemble à une ravissante version miniature de Catherine, aussi minuscule qu’une poupée. Mère n’aurait pas hésité à l’envoyer dès sa naissance loin de notre foyer pour qu’elle soit élevée par d’autres, afin de nous épargner la honte de son existence, mais père, dans un élan de compassion pour sa dernière fille frappée par le sort, a insisté pour qu’elle reste auprès de nous. Elle n’est point idiote – elle apprend bien ses leçons et possède une solide intelligence pour une si petite personne – mais la grâce de Dieu ne l’a jamais effleurée. Contrairement à père et moi, elle ne fait pas partie des élus. Une créature dans son genre, maintenue si basse par la main du diable, devrait prier pour son âme avec une ferveur décuplée. Elle n’a que cinq ans, toutefois, et est peut-être encore trop jeune pour renoncer aux plaisirs terrestres. Pour ma part, j’étudiais déjà le latin à l’âge de quatre ans, et Notre-Seigneur avait mon âge actuel lorsqu’il est allé au temple pour prêcher auprès des maîtres. Il est impératif de marcher sur les pas de Dieu dès le berceau, au risque de ne jamais trouver Sa voie.
J’étudie depuis que je suis enfant. Je dois très certainement être la jeune personne la plus instruite de tout le royaume – élevée selon les préceptes de la religion réformée, favorite de cette grande érudite et reine qu’était Catherine Parr. Aucun homme dans toute l’Europe, sans doute, n’en sait autant que moi, et probablement aucune autre femme au monde. Je ne considère pas ma cousine, la princesse Élisabeth, comme une véritable disciple, car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus,et rien ne laisse présager que la pauvre soit de ceux-ci. Ses sujets d’étude, d’ailleurs, sont concentrés sur le profane. Elle veut paraître intelligente afin de plaire à ses tuteurs et être admirée de tous. Je dois moi-même prendre garde à ne pas pécher par orgueil, même si aux dires plutôt grossiers de ma mère, mon principal souci devrait être de ne pas devenir la risée de tous. Lorsque je tente de lui démontrer qu’elle est une pécheresse, cependant, elle me prend par l’oreille et menace de m’administrer une rossée. Je subirais volontiers le bâton au nom de ma foi, comme la sainte Anne Askew, mais j’estime qu’il plaît plus à Dieu de me voir présenter mes excuses, faire la révérence et prendre place à table. Qui plus est, nous aurons droit ce soir à de la tarte aux poires avec de la crème brûlée, dont je raffole.
Il est difficile d’éclairer qui que ce soit à Bradgate, qui est une vaste demeure détournée du divin. C’est une immense bâtisse de brique, aussi rouge que Hampton Court, dont la seule porterie atteint déjà les proportions dudit palais et qui se situe au beau milieu de l’imposante forêt de Charnwood. Nous méritons ce prestige royal, car ma mère est fille de la princesse Marie, qui fut reine de France et sœur favorite du roi Henri VIII. Elle est donc héritière du trône d’Angleterre après le roi actuel, Édouard, et ses deux sœurs aînées, nos cousines, les princesses Marie et Élisabeth, qui se suivent dans l’ordre de succession. Cela fait de nous la famille la plus influente de toute l’Angleterre, et nous ne l’oublions jamais. Nous employons de nombreux domestiques, plus de trois cents, pour nous servir tous les cinq ; nous possédons des écuries remplies de magnifiques chevaux, ainsi que toutes les terres qui entourent le manoir : bois, champs, fermes, villages, rivières et lacs au cœur même de l’Angleterre. Nous avons notre propre ours, que nous gardons enfermé dans sa cage près des écuries et que nous faisons combattre dans notre fosse ; nous disposons aussi d’une arène pour les combats de coqs. Notre demeure est l’une des plus imposantes des Middle Lands. Nous avons une grand-salle avec une tribune pour les musiciens à une extrémité et une estrade royale à l’autre. La plus belle région d’Angleterre est nôtre. On m’a inculqué la certitude que ces terres nous appartiennent autant que nous appartenons à l’Angleterre.
Bien entendu, entre mère et le trône se tiennent les trois enfants royaux : Édouard, le roi actuel – qui n’a que douze ans comme moi et règne donc avec l’assistance du lord président – et ses deux sœurs aînées, les princesses Marie et Élisabeth. Certains omettent de les compter dans la succession pour la bonne raison qu’elles ont été déclarées illégitimes et ont été reniées par leur propre père. Elles ne feraient même plus partie de la famille royale sans la charité chrétienne de ma préceptrice Catherine Parr, qui les a fait admettre à la Cour et a insisté pour qu’elles soient reconnues. Pis encore, la princesse Marie – que Dieu lui pardonne – est une papiste convaincue, une hérétique. Je lui dois le respect en tant que cousine, mais il m’est tout à fait insupportable de me trouver chez elle, car elle respecte à la lettre toute la liturgie, comme si elle vivait dans un couvent et non dans un royaume protestant, puisque toute l’Angleterre a adopté la religion réformée sous le règne du roi Édouard.
Je ne dirai rien sur la princesse Élisabeth. Je ne parle jamais d’elle. Je l’ai déjà bien assez vue lorsque nous vivions toutes les deux auprès de la reine Catherine et de son jeune époux, Thomas Seymour. La seule chose que je pourrais déclarer est qu’elle devrait avoir honte et qu’il lui faudra répondre de ses actes devant Dieu. Car je l’ai vue. J’étais là lorsqu’elle s’est offerte à toutes ces attentions malsaines, tous ces gestes irrévérencieux et toutes ces flatteries malséantes de la part du mari de sa propre belle-mère. Elle a conduit Thomas Seymour – un grand homme –sur la voie de l’imprudence et cela l’a mené à sa perte. Elle est coupable de luxure et d’adultère – par le cœur, sinon par la chair. Elle est tout aussi coupable de la mort de ce brave homme que si elle l’avait accusé d’un crime de lèse-majesté, et c’est elle qui lui a valu d’être exécuté. Elle l’a sciemment poussé à se considérer comme son amant et époux, et elle lui a fait miroiter un avenir en tant que prince consort. Elle ne lui a peut-être pas promis de vive voix, mais cela ne lui était pas nécessaire, car j’ai bien vu de quelle manière elle se comportait avec lui, et je sais parfaitement ce qu’elle lui a fait faire.
Qu’à cela ne tienne, je ne juge pas. Je ne jugerai personne. Je ne juge jamais, car seul le Seigneur en a le pouvoir. Je me dois de rester humble tout en conservant un œil averti, et il me faut faire preuve de compassion, car je ne suis pas à l’abri du péché. Je doute cependant que Dieu lui accorde la moindre attention lorsqu’elle brûlera dans les flammes de l’enfer et essaiera de se repentir bien tard d’un tel manque de chasteté, de loyauté et de modestie. Dieu et moi la plaindrons, mais nous la laisserons à son châtiment éternel.
Quoi qu’il en soit, étant donné que les princesses Marie et Élisabeth ont toutes deux été déclarées illégitimes, et qu’elles feraient de si piètres souveraines, ces demi-sœurs du roi Édouard sont de facto plus éloignées de la Couronne que la fille de la reine Marie, sœur favorite du roi Henri, à savoir ma mère.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est primordial pour elle d’étudier la religion réformée et de cesser de vivre dans les richesses de ce bas monde. Elle devrait éviter de boire et manger à outrance, elle devrait danser uniquement avec les dames les plus chastes de sa maisonnée, et cesser de chevaucher partout et à toute heure sur le dos de son énorme monture, à chasser tout ce qui se présente, tel un guerrier sanguinaire. Les bois luxuriants qui entourent notre propriété résonnent des cors tandis que les rabatteurs mènent le gibier à découvert. Les chiens meurent dans la fosse, les génisses sont tuées derrière les cuisines. J’ai bien peur que ma mère ne pèche par luxure – tous les Tudors sont atteints par ce mal –, je la sais orgueilleuse – tous les Tudors naissent tyrans –, et il est clair pour tout le monde qu’elle est extravagante et adore les mondanités.
Je devrais la réprimander, mais quand j’annonce à mon précepteur que je rassemble mon courage pour dire à ma mère qu’elle est coupable, à tout le moins, d’orgueil, de colère, de gourmandise, de luxure et d’avarice, il me répond non sans inquiétude : « Lady Jane, vraiment, je ne saurais vous le conseiller. » Je sais qu’il la craint, comme tout le monde. Même père en a peur. Cela prouve d’ailleurs qu’elle est coupable d’une ambition par trop masculine, en plus de tout le reste.
J’aurais tout aussi peur d’elle que le reste de ces pauvres âmes tremblantes si je n’avais pas été ainsi portée par ma foi. Elle me soutient véritablement. Ce n’est en rien facile lorsque l’on respecte la religion réformée. Le courage est chose aisée pour les papistes ; n’importe lequel d’entre eux possède des dizaines d’objets pour lui inspirer du courage : les icônes dans les églises, les vitraux, les nonnes, les curés, le chœur, l’encens, l’arôme enivrant du vin qui selon eux a le goût cuivré du sang. Tout cela est incroyablement vaniteux et vide de sens. Je sais que ma religion me porte car je m’agenouille sur la pierre dure et froide d’une modeste chapelle, et j’entends Dieu qui s’adresse à moi d’une voix douce et aimante. J’étudie la Bible seule, personne ne me la lit, et j’entends alors la parole du Seigneur. Je prie pour trouver la sagesse et lorsque je parle, je sais que je suis fidèle à Ses enseignements. Je suis Son humble servante et je délivre Son message. C’est pour cela qu’il n’est pas du tout acceptable de laisser mère s’écrier : « Pour l’amour de Dieu, disparais de ma vue, avec ta triste mine, et va donc chasser avant que ce soit moi qui te chasse de cette bibliothèque ! »
Intolérable ! Je prie Dieu pour qu’Il lui pardonne, comme je lui pardonne. Je sais toutefois qu’Il n’oubliera pas l’offense qui m’est faite, à moi, Son humble servante ; et je ne l’oublierai pas non plus. Je vais chercher un cheval aux écuries, mais je ne vais pas chasser. Au lieu de cela, je chevauche avec ma sœur Catherine, un palefrenier sur nos talons. Nous pourrions fort bien galoper toute la journée, et cela dans n’importe quelle direction, sans atteindre jamais les limites de nos terres. Nous traversons au petit galop les prairies et passons en bordure des champs où l’avoine pousse en une opulence verdoyante ; nous franchissons les rivières à gué et laissons nos montures s’abreuver de cette eau claire. Nous appartenons à la famille royale d’Angleterre et nous menons une vie heureuse dans ces magnifiques contrées du royaume, bénies par l’héritage d’une noble lignée.
Aujourd’hui, pour une raison qui m’échappe, mère est tout sourires et j’ai été priée de revêtir ma nouvelle robe en velours pourpre, qui est arrivée de Londres la semaine dernière, avec un riche capuchon noir et des manches longues : nous recevons des invités de marque pour le dîner. Je demande à notre lord-chambellan qui est attendu et il m’annonce qu’il s’agit de l’ancien lord protecteur, Édouard Seymour, le duc de Somerset. Il a été enfermé à la Tour de Londres pour trahison, mais il a été relâché et réintégré au sein du Conseil privé. Nous vivons une époque dangereuse.
— Son fils l’accompagnera, ajoute le chambellan en osant m’adresser un clin d’œil.
Me prend-il pour une jeune fille frivole que cette nouvelle devrait faire bondir de joie ?
— Oh, comme c’est excitant ! s’extasie ma frivole de sœur.
Je laisse échapper un soupir indulgent et annonce que je vais lire dans ma chambre en attendant l’heure de m’habiller pour le dîner. Je ferme la porte pour bien signifier à Catherine que je ne souhaite pas être dérangée.
Elle ne saisit pas la subtilité.
Après un bref instant, j’entends quelqu’un frapper contre la boiserie travaillée de la porte de mes appartements privés, et je vois ma sœur passer sa tête blonde par l’ouverture.
— Oh ! tu étudiais ? s’étonne-t-elle comme si ce n’était pas ma seule et unique occupation.
— Tout à fait. C’était mon intention lorsque je me suis retranchée derrière cette porte close.
Elle ne perçoit pas non plus le sarcasme.
— À ton avis, pour quelle raison le duc de Somerset vient-il chez nous ? demande-t-elle en entrant sans y avoir été invitée.
Mary lui emboîte le pas, comme s’il s’agissait d’une chambre d’apparat à la Cour, à laquelle n’importe qui peut accéder pourvu qu’il soit convenablement vêtu.
— Comptes-tu faire entrer ce singe répugnant dans ma chambre ? m’indigné-je en voyant l’animal se tenir sur l’épaule de Catherine.
— Bien évidemment, me rétorque-t-elle d’un air offusqué. Mr Nozzle ne me quitte jamais, sauf lorsque je vais rendre visite à notre pauvre ours. Il a peur de l’ours.
— Je ne veux pas qu’il vienne ici et salisse tous mes documents de travail.
— Il se tiendra sage. Il restera sur mes genoux. Mr Nozzle est un bon singe.
— Fais-le sortir.
— Non.
— Fais-le sortir, c’est un ordre.
— Je refuse.
— Je suis l’aînée et il s’agit de ma chambre…
— Je suis la plus belle et ceci est une visite de courtoisie…
Nous nous fustigeons mutuellement du regard, puis elle me montre la chaîne en argent qui retient le petit singe par le cou.
— Jane, s’il te plaît ! Je le garderai tout près de moi, promet-elle.
— Oh, laisse-moi le prendre sur mes genoux ! s’exclame Mary.
Je me retrouve donc seule face à mes deux sœurs bien décidées à m’imposer la présence d’un singe qui n’a rien à faire ici.
— Allez-vous-en, toutes les deux ! ordonné-je avec agacement.
Catherine, cependant, se penche et soulève Mary pour la placer sur une chaise. La petite chose, pareille à une poupée, lève un visage souriant vers moi avec tout le charme du monde.
— Tiens-toi droite, lui rappelle Catherine.
Notre cadette ramène les épaules en arrière pour maintenir une posture parfaite.
— Non ! me récrié-je. Allez-vous-en !
— Je m’en irai dès que tu auras répondu à une question, décrète Catherine.
Elle me regarde avec un sourire radieux, contente de faire à sa guise, comme toujours. Elle possède une beauté sans pareille et une capacité de raisonnement proche de celle de Mr Nozzle.
— Très bien, cédé-je à contrecœur. Pose ta question, puis va-t’en.
Elle prend une grande respiration.
— Pour quelle raison, selon toi, le duc de Somerset nous rend-il visite ?
— Je n’en ai pas la moindre idée.
— Eh bien, moi, si. Comment se fait-il que tu ne le saches pas, toi qui es censée être si sublimement intelligente ?
— Je n’ai aucune envie de le savoir, rétorqué-je simplement.
— Je peux te le dire. Toi, tu ne connais que les choses dans les livres.
— « Les choses dans les livres. » (Je répète les mots d’une jeune ignorante.) Tu as raison, je sais ces « choses dans les livres », mais si je m’intéressais aux mondanités, j’irais trouver père, qui me dirait la vérité. Je n’irais pas écouter les conversations de nos parents, ni prêter l’oreille aux rumeurs que colportent les serviteurs.
Ma sœur se laisse tomber sur mon grand lit comme si elle prévoyait de rester jusqu’à l’heure du dîner, puis elle se cale contre le coussin comme si elle s’attendait aussi à dormir là. Le singe se met à l’aise à côté d’elle et passe une petite main chétive dans ses poils soyeux.
— Est-ce qu’il a des puces ?
— Oh, oui, répond Catherine d’un air détaché. Mais il n’a pas de poux.
— Fais-le tout de suite descendre de mon lit !
Elle le soulève et le pose sur ses genoux.
— Tu vas voir, c’est incroyablement excitant. On vient pour te fiancer ! déclare-t-elle. Ah ! Je savais que cela te surprendrait.
Je suis si peu surprise que je parviens à garder le doigt sur la page, là où j’ai arrêté ma lecture.
— Où as-tu entendu pareille chose ?
— Tout le monde le sait, dit-elle. (Ce qui signifie que, comme je le pensais, il s’agit de rumeurs provenant des serviteurs.) Oh, tu as tant de chance ! Je pense que Ned Seymour est le jeune homme le plus séduisant au monde.
— Certes, mais tu te pâmes devant tout ce qui porte des hauts-de-chausses.
— Il a des yeux si doux.
— Il doit bien avoir des yeux, mais ils ne peuvent pas être doux. Il est possible d’avoir le regard perçant, mais des yeux ne peuvent exprimer la douceur.
— Et un si charmant sourire.
— Je suppose qu’il a la capacité de sourire, comme tout le monde, mais je n’y ai jamais prêté attention.
— Et il monte avec tant d’élégance, et il s’habille de si belle manière, et il est le fils de l’homme le plus puissant d’Angleterre. Aucune famille n’est plus influente que les Seymour. Aucune n’est plus riche. Ils sont même plus proches du trône que nous.
Je pense, mais je n’en dis rien, que la grandeur de cette famille n’a pas été d’un grand secours à Thomas Seymour, qui a été décapité pas plus tard que l’année dernière à cause d’Élisabeth, et que pas même son frère aîné n’a pu le sauver. À la suite de cela, ce fut au tour du frère, le lord protecteur lui-même, de tomber en disgrâce ; il s’échine à présent à recouvrer sa place à la Cour.
— Le superbe fils du lord protecteur, soupire Catherine.
Comme à son habitude, elle se perd en rêveries.
— Son père n’est plus le lord protecteur ; cette fonction a été abolie, précisé-je. Le Conseil est à présent mené par le lord président, John Dudley. Si tu souhaites une union avec une famille qui a le vent en poupe, alors cherche du côté des Dudley.
— Il est toujours l’oncle du roi, et Ned est toujours le comte de Hertford.
— « Édouard Seymour », rectifié-je.
— « Édouard » ou « Ned », quelle différence ?
— Et tout le monde dit que je vais lui être promise ? demandé-je.
— Oui. Et quand tu seras mariée, tu devras à nouveau partir. Tu me manqueras grandement. Même si tu ne sais que me répéter combien je suis stupide, je préfère de loin lorsque tu es ici. Tu m’as beaucoup manqué lorsque tu es allée vivre auprès de la reine Catherine. Je dois bien avouer que j’ai été heureuse d’apprendre qu’elle était morte – même si j’étais fortement désolée pour elle, bien entendu – parce que je pensais que tu reviendrais pour toujours.
— Ne t’en va pas, Jane, se met soudain à supplier Mary sans bien comprendre ce qui se passe.
Quand bien même la Bible nous apprend qu’un fidèle doit, par amour de l’Évangile, accepter de quitter maison, frères, sœurs, mère et père, je dois avouer que cela me touche.
— Si ma destinée est de jouer un plus grand rôle en ce monde, alors il me faudra partir, déclaré-je. Notre cousin le roi Édouard règne sur une Cour divine, et plaise à Dieu que j’en fasse partie, car il me serait ainsi possible d’être un modèle pour ceux qui reconnaîtraient en moi la vérité. Alors, quand ton tour viendra, je te montrerai ce qu’il faut savoir, et tu feras comme je te le dirai. Pour autant, tu me manqueras, et Mary aussi, si je dois vous quitter.
— Est-ce que Mr Nozzle te manquera ? s’enquiert Catherine avec espoir en glissant du lit tout en me tendant son animal de compagnie,dont la petite tête triste n’est plus qu’à un cheveu de la mienne.
— Non, réponds-je en repoussant délicatement ses mains.
— Quand mon tour sera venu, j’espère que mon mari sera aussi beau que Ned Seymour, enchaîne-t-elle. Cela ne me dérangerait pas non plus de devenir la comtesse de Hertford.
Je me rends alors compte que cela va sans doute bientôt être mon nouveau nom et mon nouveau titre. À la mort de son père, qui plus est, Ned deviendra le duc de Somerset et je serai duchesse.
— Que la volonté de Dieu soit faite, dis-je, en songeant aux feuilles de fraisier qui ornent le diadème d’une duchesse, ainsi qu’à la douceur inégalable de l’hermine autour de mon cou.
— Pour toi autant que pour moi, ajouté-je.
— Amen, répond Catherine sur un ton rêveur. (Elle songe apparemment encore au sourire de Ned Seymour.) Oh ! Amen.
— Je doute fortement que Dieu fasse de toi une duchesse, tempéré-je.
Elle me dévisage en écarquillant ses beaux yeux bleus, ses joues, aussi pâles que les miennes, se teintant de rose.
— Oh, prie pour que ce soit le cas, m’implore-t-elle avec une confiance aveugle. Tu peux faire que j’épouse un duc, si tu pries pour moi, Jane. Tu es si pieuse que tu peux me faire épouser un duc à coup sûr, si tu en fais la requête à Dieu. Demande-Lui de m’en trouver un beau.
Force est d’admettre que Catherine a raison : Ned Seymour est aussi charmant que tous les hommes de sa famille. Il me rappelle son oncle Thomas – le mari de ma préceptrice Catherine Parr, avant qu’Élisabeth détruise leur bonheur. Il était l’homme le plus charitable qu’il m’ait été donné de rencontrer. Ned a les cheveux châtains et les yeux marron. Je n’avais jamais remarqué auparavant que des yeux pouvaient être doux, mais je dois avouer que ma sœur avait raison. Qui plus est, son sourire est fort plaisant et chaleureux. J’espère que Ned ne nourrit aucune pensée déplacée derrière cet éclat pétillant. Il a vécu à la Cour en tant que compagnon auprès de mon cousin le roi, et nous nous connaissons donc déjà. Nous avons chevauché, nous avons appris à danser, et nous avons même étudié ensemble. Il pense, comme moi – et comme tout le monde –, que tous les jeunes gens intelligents sont protestants. Je le considère comme un ami, si tant est que l’on puisse considérer quiconque comme un ami dans l’arène impitoyable qu’est une Cour royale. Il prône activement la religion réformée, ce qui nous rapproche encore, et derrière cette apparente légèreté se cache un esprit sérieux et appliqué. Mon cousin le roi Édouard partage cette gravité et ce goût de l’érudition, et nous aimons beaucoup lire ensemble. Ned Seymour, toutefois, est celui qui ne manque jamais de nous faire rire. Il ne se montre jamais grivois – mon cousin le roi n’accepterait jamais de sots à sa Cour – mais il sait se révéler fin, et il possède une élégance indéniable ; il a ce charme des Seymour qui lui permet de se lier d’amitié avec tous ceux qu’il rencontre. Il est ce genre de garçon à qui l’on ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’on le croise. Oui, c’est tout à fait lui.
Je suis assise à table avec les dames de compagnie de ma mère tandis qu’il est entouré des gens de son père. Nos parents sont réunis à la table d’honneur, sur l’estrade qui surplombe toute la grand-salle. Ils nous observent de leur promontoire. En voyant la façon qu’a ma mère de dresser trop fièrement le menton, je me dis que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Je suis certaine qu’elle, en particulier, ne sera jamais élue ; lorsque je deviendrai duchesse, mon rang sera supérieur au sien, et elle ne pourra plus jamais proférer de jurons en ma présence.
Lorsque les tables ont été débarrassées, les musiciens se mettent à jouer et je reçois l’ordre d’aller danser avec les dames de l’entourage de ma mère ainsi qu’avec ma sœur Catherine. Celle-ci, bien évidemment, ne perd pas l’occasion de faire voler ses jupes et de les soulever trop haut, de sorte que tous peuvent admirer ses jolies pantoufles et l’éclat opalin de ses chevilles. Elle ne cesse de lancer des sourires en direction de la table d’honneur, où Ned se tient derrière la chaise de son père. Que Dieu lui pardonne, Ned nous décoche même un clin d’œil. Je pense qu’il nous adresse à toutes les deux ce geste, et non à Catherine seulement. Je suis ravie qu’il nous regarde danser – même si ce clin d’œil me déçoit de sa part.
Lorsque arrive l’heure de la danse en couple, mère me donne l’ordre de le prendre comme cavalier. Chacun s’émerveille de voir que nous allons si bien ensemble, quand bien même Ned me dépasse d’une bonne tête. Je suis, pour ma part, très petite et pâle ; toutes les femmes de la famille Grey sont plutôt frêles. Je me réjouis toutefois d’être délicate et non corpulente comme la princesse Élisabeth.
— Vous dansez magnifiquement bien, me complimente Ned lorsque nous revenons l’un auprès de l’autre et attendons qu’un autre couple termine ses pas. Savez-vous pour quelle raison mon père et moi sommes ici ?
Nous sommes contraints de nous séparer pour le prochain mouvement de la danse et cela me donne un peu de temps pour réfléchir à une réponse digne.
—
— Non, et vous ?
Je ne trouve rien d’autre à dire.
Il me prend par la main alors que nous remontons l’allée de danseurs, puis nous nous plaçons l’un en face de l’autre et formons une arche avec nos bras. Il m’adresse un sourire alors que les couples suivants baissent la tête et passent sous nos mains jointes.
— Nos familles souhaitent que nous nous mariions, déclare-t-il avec entrain. La chose est entendue. Nous allons devenir mari et femme.
Nous devons nous éloigner l’un de l’autre pour laisser le prochain couple venir se placer à l’autre bout de l’allée, et il a tout le loisir de lire la réponse sur mon visage. Je sens le rouge me monter aux joues et tente de recouvrer mon sang-froid afin d’éviter de passer pour une jeune fille en pâmoison.
— C’est à mon père de m’annoncer une telle chose, rétorqué-je abruptement.
— Serez-vous heureuse lorsqu’il le fera ?
Je baisse le regard afin qu’il ne puisse pas deviner le fond de ma pensée. Je déplore la façon dont mes yeux marron doivent briller à l’instant.
— Je me dois, en accord avec la parole de Dieu, d’obéir à mon père, éludé-je.
— Serez-vous heureuse de lui obéir et de m’épouser ?
— Tout à fait.
Mes parents pensent manifestement que je suis la dernière personne à consulter, car je ne suis convoquée dans les appartements de ma mère que le lendemain, alors qu’Édouard et son père se préparent à partir et que leurs chevaux les attendent déjà devant les portes d’entrée ouvertes par lesquelles entre le parfum de la campagne anglaise au printemps, en même temps que les chants guillerets des oiseaux à la saison des amours.
J’entends les serviteurs transporter les sacoches de selle dans le vestibule en bas tandis que je m’agenouille devant mes parents et que ma mère adresse un signe de tête à un domestique pour qu’il referme la porte.
— Tu as été promise à Édouard Seymour, déclare ma mère sans préambule. Promise, mais tu n’es pas officiellement fiancée. Avant cela, il nous faut voir si son père saura recouvrer sa place au Conseil et travailler main dans la main avec John Dudley. C’est Dudley, l’homme qui compte, dorénavant, et nous devons nous assurer que Seymour le comprend et l’accepte.
— À moins que l’autre occasion ne se présente, précise mon père en adressant à ma mère un regard de connivence.
— Non, il ne fait aucun doute qu’il épousera une princesse étrangère, réplique ma mère.
Je devine immédiatement qu’ils parlent du roi Édouard, qui a annoncé officiellement qu’il s’unirait à une princesse étrangère avec une dot royale. Je n’ai quant à moi jamais songé qu’il agirait autrement, même si certaines personnes disent que je ferais une reine parfaite, que je serais un guide spirituel et un modèle de la religion protestante, et que j’accélérerais la réforme dans un pays qui, encore aujourd’hui, ne met pas tout son cœur à cet ouvrage. Je garde la tête baissée sans un mot.
— Ils formeraient pourtant un couple si parfait, plaide mon père. Ils sont tous les deux très instruits et très pieux. Notre Jane, qui plus est, serait l’héritière parfaite de l’œuvre de Catherine Parr. Nous avons élevé notre fille et la lui avons confiée pour cela.
Je peux sentir sur moi le regard insistant de ma mère, mais je ne lève pas les yeux vers elle.
— Elle transformerait la Cour en couvent ! s’exclame-t-elle par dérision.
— La lumière du monde, contre mon père avec sérieux.
— Je doute que cela arrive un jour. Quoi qu’il en soit, lady Jane, considère-toi comme promise en mariage à Édouard Seymour tant que nous n’en décidons pas autrement.
Mon père me prend délicatement par le bras et m’incite à me relever.
— Tu seras duchesse, ou mieux encore, me promet-il. Ne veux-tu pas savoir ce qui serait mieux encore ? Que dirais-tu de monter sur le trône d’Angleterre ?
— Mon attention est portée vers le royaume des cieux, réponds-je en secouant la tête tout en restant indifférente au grossier renâclement sarcastique de ma mère.
..................................................................................................................................................................
Biographie;
Philippa Gregory, née le 9 janvier 1954, est une historienne, écrivain britannique associé au genre de la fiction historique. Elle est particulièrement connue pour son roman The Other Boleyn Girl (en) (2001), dont est inspiré le film Deux sœurs pour un roi (2008) ; ainsi que pour ses œuvres The White Queen (en), The Red Queen (en) et The Kingmaker’s Daughter (en), dont est inspirée la série télévisée de la BBC The White Queen.
Certains de ses ouvrages ont été traduits en français.
Série Cousins’ War
The Lady of the Rivers (2011)
L'histoire de Jacquette de Luxembourg, à partir de l'an 1430. Née noble, épouse du Duc de Bedford (frère du roi Henri V) et demoiselle d'honneur de la reine d'Angleterre Marguerite d’Anjou, elle renonce à ses titres et à sa fortune par amour pour épouser Richard Woodville.
Parmi les enfants issus de cette seconde union, figure la célèbre Elizabeth Woodville, future reine d'Angleterre.
La Reine clandestine (The White Queen, 2009)
La Reine clandestine (trad. Céline Véron Voetelink),L’Archipel, janvier 2013 (ISBN 978-2-8098-0990-9)
Débutant en 1464, l'histoire d’Elizabeth Woodville et de son mariage avec le roi Edward IV d’Angleterre, rythmée par les conflits sanglants entre Lancaster et York.
Le nom de White Queen fait référence à la couleur de la rose blanche qui symbolise le clan des York, dont Elizabeth Woodville fait partie de par son mariage avec Edward IV.
The Red Queen (2010)
Débutant en 1453, ce livre couvre presque la même période que The White Queen mais l'histoire est cette fois racontée du point de vue de Margaret Beaufort, qui a consacré sa vie à tout mettre en œuvre pour que son fils Henri Tudor, exilé toute son enfance en France, prenne le trône d'Angleterre.
Le nom de Red Queen fait référence à la couleur de la rose rouge qui symbolise le clan des Lancaster, dont Margaret Beaufort fait partie.
La Fille du faiseur de rois (The Kingmaker’s Daughter, 2012)
La Fille du faiseur de rois (trad. Sarah Dali), Hugo & Cie, juin 2015 (ISBN 978-2-7556-1764-1)
Débutant en 1465, ce livre couvre également la même période que les deux précédents mais cette fois du point de vue d’Anne Neville, fille du « faiseur de roi » Warwick, épouse du Prince de Galles Edward de Westminster puis du roi Richard III d’Angleterre (frère d’Edward IV d’Angleterre).
Cet ouvrage relate également l'histoire de la sœur aînée d'Anne Neville, Isabelle Neville, épouse de George duc de Clarence (également frère d’Edward IV d'Angleterre).
La Princesse blanche (The White Princess, 2013)
La Princesse blanche (trad. Sarah Dali), Hugo & Cie, novembre 2014 (ISBN 978-2-7556-1700-9)
Débutant en 1485, l'histoire d’Elizabeth d’York, fille de la reine Elizabeth Woodville et du roi Edward IV d’Angleterre, future épouse du roi Henri VII d’Angleterre dont le mariage servira à sceller une bonne fois pour toutes l'alliance entre Lancaster (Henri VII, fils de Margaret Beaufort) et York (Elizabeth d’York, fille d’Edward IV).
La Malédiction du roi (The King’s Curse, 2014)
La Malédiction du roi (trad. Sarah Dali), Hugo & Cie, octobre 2015 (ISBN 978-2-7556-1841-9)
L'histoire de Margaret Pole, fille de George duc de Clarence et d’Isabelle Neville, et nièce des rois Edward IV d’Angleterre et Richard III d’Angleterre. Lorsque Henri VII prend le pouvoir et cherche à éliminer tout prétendant au trône, Margaret Pole peut fuir le poids de son nom en se mariant mais ce n'est pas le cas de son jeune frère, emprisonné dès son enfance dans la Tour de Londres.
Série Tudor Court
Les six livres composant cette série sont sortis dans l'ordre suivant (dates de parution au Royaume-Uni) :
Deux sœurs pour un roi / The Other Boleyn Girl (2001)
The Queen’s Fool (2003)
The Virgin’s Lover (2004)
La Princesse d'Aragon / The Constant Princess (2005)
L’Héritage Boleyn / The Boleyn Inheritance (2006)
The Other Queen (2008)
Toutefois, l'ordre de sortie de ces livres ne respecte pas l'ordre chronologique narratif. Ainsi, le lecteur qui souhaite suivre le cours historique des événements devrait plutôt les lire dans l'ordre ci-dessous.
La Princesse d'Aragon (The Constant Princess, 2005)
La Princesse d'Aragon (trad. Mathias Lefort), Hauteville, 2020 (978-2381221465)
Sortie en 2005, cette œuvre raconte une version romancée de la vie de Catalina of Aragon, également appelée Catherine d'Aragon, fille d’Isabelle Ire de Castille et de Ferdinand II d’Aragon.
Le livre débute en 1491, quand la princesse n'a encore que 6 ans, dix ans avant qu'elle n'aille rejoindre la cour du roi Henri VII d’Angleterre pour épouser sont fils aîné Arthur.
Deux sœurs pour un roi (The Other Boleyn Girl, 2001)
Deux sœurs pour un roi (trad. Céline Véron Voetelink), L’Archipel, mai 2009 (ISBN 978-2-35287-119-4)
Cet ouvrage, parmi les plus connus de Philippa Gregory, a donné lieu à l'adaptation cinématographique Deux sœurs pour un roi.
Cette fiction historique raconte les vies des sœurs Anne et Mary Boleyn, à la cour du roi Henri VIII, alors époux de la reine Catherine d’Aragon. L'histoire est racontée du point de vue de Mary Boleyn et débute en 1521.
L’Héritage Boleyn (The Boleyn Inheritance, 2006)
L’Héritage Boleyn (trad. de l'anglais), Paris, L’Archipel, avril 2010, 449 p. (ISBN 978-2-8098-0175-0)
Débutant en 1539, cette fiction historique relate également la vie de la cour du roi Henri VIII d'Angleterre, mais en adoptant cette fois trois points de vue différents :
celui de Jane Parker-Boleyn, née en 1505, qui apparaissait déjà dans The Constant Princess et The Other Boleyn Girl en tant que personnage secondaire ;
celui d’Anne de Clèves, née en 1515, et future 4e épouse du roi Henri VIII d'Angleterre ;
celui de Catherine Howard, née en 1523 et future 5e épouse du roi Henri VIII d'Angleterre.
The Queen’s Fool (2003)
Cette œuvre commence en 1548 et raconte l'histoire d'un personnage fictif du nom de Hannah Verde (Hannah Green), une jeune fille de confession juive qui fuit l’Inquisition espagnole avec son père pour trouver refuge en Angleterre, où ils se font passer pour chrétiens, et se retrouve à la cour du roi Edward VI d’Angleterre, puis de la reine Mary Ire d’Angleterre (fille de Catherine d'Aragon) et d’Élisabeth Ire d’Angleterre (fille d’Anne Boleyn).
À travers cette fiction, Philippa Gregory dresse les portraits de Mary Ire et d’Élisabeth Ire, dans une Angleterre déchirée entre catholiques et protestants.
The Virgin’s Lover (2004)
En 1558, Mary Ire d'Angleterre décède et Elizabeth Ire d'Angleterre prend le pouvoir.
Cette œuvre raconte les vies de Elizabeth Ire, son fidèle compagnon et amant Robert Dudley, ainsi que l'épouse de ce dernier, Amy Robsart-Dudley.
The Other Queen (2008)
L'œuvre débute en 1568, Elizabeth Ire d'Angleterre est au pouvoir depuis dix ans. Elle raconte l'histoire de Mary Queen of Scots (Marie Ire d’Écosse), également connue sous le nom de Marie Stuart (du nom de la dynastie Stewart de son père) promise à un avenir extraordinaire de par son héritage de deux trônes européens et son alliance avec un troisième :
le trône d’Écosse (en tant que monarque de plein droit) de par son père le roi James V of Scotland (Jacques V d’Écosse) et de par sa mère la reine d’Écosse Marie de Guise ;
le trône d'Angleterre (également de plein droit) de par sa grand-mère, la sœur du roi Henri VIII, et en étant elle-même cousine de la reine Elizabeth Ire ;
le trône de France (en tant que reine consort) de par sa position de belle-fille du roi Henri II de France et épouse du dauphin François II de France.
Sur ordre de sa cousine Elizabeth Ire d'Angleterre, elle-même conseillée par William Cecil, Marie Stuart est emprisonnée dans les demeures de George Talbot, 6e comte de Shrewsbury, et de son épouse Bess de Hardwick comtesse de Shrewsbury.
L'ouvrage adopte ainsi trois points de vue : celui de Marie Stuart ; celui de George Talbot ; et celui du fascinant personnage de Bess de Hardwick, fille d'un fermier qui a su s'élever aux plus hautes positions d'Angleterre.
Série des Plantagenêt et Tudor
Originellement séparés dans les séries Tudor Court et Cousins’ War, ces romans sont regroupés par Philippa Gregory dans une série commune, The Plantagenet and Tudor novels3,4, qu’elle complète par de nouveaux romans.
L’auteur a suggéré un « ordre de lecture » pour la série, d’après la chronologie des personnages historiques et des événements réels5.
Chronologie de parution
The Other Boleyn Girl (2001)
The Queen’s Fool (2003)
The Virgin’s Lover (2004)
The Constant Princess (2005)
The Boleyn Inheritance (2006)
The Other Queen (2008)
The White Queen (2009)
The Red Queen (2010)
The Lady of the Rivers (2011)
The Kingmaker’s Daughter (2012)
The White Princess (2013)
The King’s Curse (2014)
La Dernière Reine / The Taming of the Queen (2015)
Three Sisters, Three Queens (2016)
Reines de sang / The Last Tudor (2017)
Chronologie historique
The Lady of the Rivers (Jacquette de Luxembourg)
The White Queen (Élisabeth Woodville)
The Red Queen (Marguerite Beaufort)
The Kingmaker’s Daughter (Isabelle et Anne Neville)
The White Princess (Élisabeth d'York)
The Constant Princess (Catherine d'Aragon)
The King’s Curse (Margaret Pole)
Three Sisters, Three Queens (Marguerite Tudor, Mary Tudor et Catherine d’Aragon)
The Other Boleyn Girl (Mary et Anne Boleyn)
The Boleyn Inheritance (Jane Boleyn, Anne de Clèves et Catherine Howard)
The Taming of the Queen (Catherine Parr)
The Queen’s Fool (le récit par une jeune fille juive de son service à la cour d’Édouard VI, Marie Ire et Élisabeth Ire)
The Virgin’s Lover (Élisabeth Ire, Robert Dudley et Amy Robsart)
The Last Tudor (Jeanne, Catherine et Marie Grey)
The Other Queen (Marie Stuart, George Talbot (en) et Bess de Hardwick)
Three Sisters, Three Queens (2016)
En 1501, Catherine d'Aragon arrive à la cour d’Angleterre pour devenir reine consort. Elle y rencontre ses nouvelles belles-sœurs : Margaret qui sera reine d’Écosse et Mary qui sera reine de France.
La Dernière Reine (The Taming of the Queen, 2015)
La Dernière Reine (trad. Fanny Adams), Hauteville, juin 2018, 646 p. (ISBN 978-2-8112-3131-6)6
Cette œuvre commence en 1543 et raconte l'histoire de Catherine Parr, la dernière épouse d’Henri VIII, qui lui survivra.
Reines de sang (The Last Tudor, 2017)
Reines de sang (trad. de l'anglais par Mathias Lefort), Paris, Hauteville, juillet 2019, 733 p. (ISBN 978-2-8112-3130-9)7
À partir de 1550, l'histoire des sœurs Grey : Jane, Catherine et Mary, petites-filles de Mary, la sœur cadette d’Henri VIII. L’aînée sera reine pendant neuf jours avant d'être exécutée par Mary Ire. Les autres survivront-elles dans l’ombre d’Elizabeth Ire ?
Autres ouvrages
Wideacre - Les Arpents du diable
Wideacre (1987)
The Favoured Child (1989)
Meridon (1990)
Earthly Joys et Virgin Earth
Fallen Skies (1994) - Les Dernières Lueurs du jour (1999)
The Little House (1996) - L’enfant dormira peut-être (1999)
A Respectable Trade (1996) - Les Enchaînés (1996)
The Wise Woman (2002) - Sous le signe du feu
The Order of Darkness - Hérétiques
Changeling (2012) - Le Mystère Isolde (2013)
Stormbringers (2013) - L’Ordre des ténèbres (2014)
Fools’ Gold (2014)
Dark Tracks (2018)
Adaptations au cinéma et à la télévision
The Other Boleyn Girl (en) (2003 sur la BBC), d’après le roman homonyme
Deux sœurs pour un roi (2008), d’après The Other Boleyn Girl
The White Queen (2013 sur la BBC), d’après The White Queen, The Red Queen et The Kingmaker’s Daughter
The White Princess (2017 sur Starz), d’après le roman du même nom
The Spanish Princess (2019 sur Starz), d’après The Constant Princess et The King’s Curse
La Maison indigène
Biographie:
Christophe Claro, né à Paris le 14 mai 1962, et plus connu sous le simple nom de Claro, est un écrivain, traducteur et éditeur français. Il est le petit-fils de Léon Claro, une figure importante de l'architecture française en Algérie.
Christophe Claro passe son enfance en banlieue parisienne. Après des études de lettres supérieures au lycée Lakanal de Sceaux, il travaille en librairie de 1983 à 1986, et devient correcteur pour différentes maisons d'édition. Il publie son premier roman, Ezzelina, aux éditions Arléa en 1986. Sa première traduction, Kilomètre zéro de Thomas Sanchez, paraît en 1990.
Menant en parallèle ses activités d'écrivain et de traducteur, il publie ensuite régulièrement des romans et récits tout en traduisant de grands noms de la littérature anglo-saxonne contemporaine, parmi lesquels William T. Vollmann, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, John Barth, Mark Z. Danielewski, James Flint, William H. Gass et Hubert Selby Jr. Il se décrit comme étant un « chasseur de trésors littéraires ».
Depuis 2004, Claro est en outre co-directeur avec Arnaud Hofmarcher de la collection « Lot 49 » (fiction américaine) aux éditions Le Cherche midi
...............................................................................................................................................................
RÉSUMÉ:
Ce livre est, à sa façon, une visite : non seulement de la maison que ?t bâtir, en 1930, l'architecte Léon Claro, grand-père de l'auteur, pour rendre hommage au style néomauresque lors du centenaire de l'Algérie française, mais également de tout un passé - intime, historique, littéraire, politique - auquel l'écrivain avait toujours refusé de s'intéresser. Reconnaissant en?n, dans cette maison indigène, une vraie "boîte noire" dont il importe d'extraire la mémoire, Claro apprend qu'elle a été visitée en 1933 par un jeune homme de vingt ans, Albert Camus, lequel en ressortit littéralement ébloui et écrivit alors un de ses tout premiers textes : "La Maison mauresque", véritable acte de naissance littéraire du futur prix Nobel. Mais la "Villa Claro" - ainsi qu'on l'appelait parfois - a également accueilli un autre créateur : Le Corbusier, que Léon Claro convia à Alger en 1931 et qui, à cette occasion, s'égara dans la Casbah, allant jusqu'à s'aventurer dans une autre maison, "close" celle-là, où l'attendait le secret de son esthétique à venir.
Au cours de cette enquête, Claro est amené à croiser d'autres visiteurs, tel le poète Jean Sénac, qui avait pris son père en amitié, mais aussi Visconti, venu à Alger tourner l'adaptation de L'Étranger. Camus, Sénac, Le Corbusier, et quelques autres, tous fascinés par la Ville Blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d'Algérie - et chacun détenant, à sa manière, une clé de la "maison mauresque" : il fallait donc forcer des serrures, pousser des portes. Dont une, inattendue, donnant sur une pièce que l'écrivain croyait vide : celle du père.
....................................................................................................................................................................
Chanter pour apaiser
Ci-gît une maison blanche dont le cœur à ciel ouvert laisse résonner autre chose que des pas. Où personne n’a jamais vécu mais que chacun ou presque peut hanter. En guise de pulsation, quand le soir tombe et avec lui notre soif d’élévations, on y perçoit l’écho des noms dont on l’a affublée, des noms rafistolés au fil des ans par l’Histoire, et qui tous ont échoué à ternir ses aspirations solaires. On l’appela dans un premier temps la Maison indigène, ou Maison mauresque, mais certains préféraient dire : la Maison du Centenaire, ou encore la Villa du Centenaire, puisqu’elle avait été inaugurée à Alger en 1930, à l’occasion du centenaire de la présence française en Algérie. Après l’Indépendance, elle devint, à la suite d’une impressionnante dilatation temporelle, la Maison du Millénaire – la vieille Al-Jazā’ir ayant alors purgé vaillamment ses dix siècles d’existence.
Qu’elle soit centenaire ou millénaire, mauresque ou algérienne, française ou ottomane, je la sais secrète et complexe, tout en bruissements contenus, au sein même de son silence. Comme toutes les maisons, elle a désiré des hommes dans son ventre de pierre, et comme toutes les maisons, elle a pris soin de leur rappeler qu’ils n’étaient que des hôtes éphémères. Des silhouettes s’y découpent, certaines familières, d’autres plus énigmatiques, mais toutes ont à mes yeux l’attrait de fantômes précieux. Je distingue des accents, je reconnais certaines allures. Ce sont mes étrangers premiers, mes proches d’antan. Vers eux, aujourd’hui, je vais. À reculons, en espérant que le mur de cette maison aura la tiédeur d’un torse ami.
*
Située en marge de la Casbah, sur une place portant naguère le nom de place d’Estrées, la Maison indigène laisse passer les révolutions, celles des astres comme celles des hommes, peu lui importe, car quels que soient ses maîtres elle rafraîchira leur couche, et s’il faut brûler elle brûlera. Sa façade évoque de très antiques molaires aux racines incurvées – de fins étançons de thuyas –, ornées de modestes caries – d’étroites percées inaccessibles à la curiosité des passants. Tout en haut, là où dore son crâne, s’étend une terrasse d’où l’on peut voir, si l’on tourne le dos à la ville, tout ce qu’une mer peut offrir à ses enfants et à ses démunis. Tissée sur le métier d’un songe néomauresque, enrichie par la chair même des ruines de la basse Casbah, elle offre au seul ciel la vision de sa cour intérieure – wast ed-dar – que protègent d’on ne sait quoi des arcades ogivales disposées en portiques, abouchées à quelques chambres aveugles. Un escalier s’enfuit dans la béance d’un angle, desservant des pièces principales qui doivent leur fraîcheur à la paupière des coupoles ; plus haut, après la dernière marche, paresse un toit où se plaisent à claquer les voiles des draps quand le vent se lève, un étage quasi céleste réservé aux femmes interdites.
On pénètre dans la Maison indigène par un vestibule qui va s’élargissant avec fluidité en une sqiffa avant d’aboutir au bienveillant atrium – là, une fontaine fait ce que font toutes les fontaines : chanter pour apaiser. Non loin, derrière ses murs, là où le monde persiste à s’agiter, des jardins et des boutiques pour touristes laissent monter vers elle parfums et barguignages, tandis que des lauriers roses lancent leurs fragrances autour des membres torves de ses figuiers.
Un gouvernement l’a commandée. Un architecte l’a bâtie. Un président l’a inaugurée. Des hommes de bonne volonté l’ont visitée. Dessinée, photographiée, filmée, reproduite, commentée, décrite, délaissée, restaurée, elle a gardé son visage originel, et si sa persistance dit aujourd’hui autre chose que la célébration d’une présence imposée, elle n’en a pas moins l’âge de mon père et le regard de mon grand-père, puisque le premier est né dans son ombre et que l’autre l’a plantée en plein soleil.
.....................................................;
Des visiteurs plus sensibles
La Maison du Centenaire a été construite à la limite, et non au sein de l’antique Casbah, évitant ainsi aux touristes et aux curieux l’embarras d’une errance dans cette zone opaque. La place d’Estrées, appelée plus communément alors place de la Bombe (on y avait retrouvé un siècle plus tôt une bombe datant de l’époque de la régence ottomane), est bordée d’un côté par un dispensaire, où une femme de courage, le Dr Legey, proposait gratuitement des soins aux musulmanes, et de l’autre par un poste de police à l’aspect délabré, où d’autres soins, moins cléments n’en doutons pas, étaient prodigués. Au-dessus s’élance la Casbah, dont la revue L’Afrique du Nord illustrée, dans son numéro du 6 juillet 1935, nous donne la description suivante, sous la plume de Robert Randau, administrateur colonial et fondateur de la littérature algérianiste :
Les dernières cassines de la rue de la Casbah sont bâties à l’européenne ; de petits commerces y prospèrent sans doute ; mais le centre important des affaires est constitué par un vaste café maure ; de l’aurore à une heure tardive de la nuit il regorge de flâneurs, qui hument des tasses de café ou de petits verres de thé à la menthe, poussent les dominos sur la table, frappent les pions sur le damier, battent les brèmes espagnoles les plus crasseuses que j’aperçus de ma vie. On parle ici tous les patois arabes ou berbères de l’Algérie et le tapage ne s’interrompt point ; on conte, on chante, on mange, on fume, on se querelle ; un phonographe ne cesse de dévider des chants nasillards égyptiens, syriens ou tunisiens ; manœuvres, dockers, émigrants du bled, semmachs, boutiquiers, marchands ambulants, burnous propres et guenilles se donnent rendez-vous à cet endroit de plaisir ; ils sont entre eux et se divertissent de tout cœur.
À l’écart de ce “tapage”, pour ainsi dire en cale sèche, la Maison indigène semble attendre, à la croisée des temps, à la lisière des heurts. Qu’attend-elle ? Des visiteurs plus sensibles ? Une bombe plus responsable ? Un bouleversement né de son ombre même ? N’est-elle qu’une fantaisie destinée à satisfaire la curiosité du passant en redingote, las du soleil autant qu’épris d’orientalisme ? Blanche et mutique, que dit-elle de la conscience coloniale ? de l’art néomauresque ? du temps qui passe, puis explose, puis passe encore?
Et si elle était tout autre chose ? Une matrice. Une page vierge dressée à la verticale, en attente d’une encre empathique, capable de mettre en branle un destin.
La Maison indigène est l’œuvre d’un architecte français : Léon Claro, mon grand-père paternel, né à Oran le 24 juin 1899, ayant fait ses études à l’École des beaux-arts d’Alger entre 1917 et 1919, marié depuis cinq ans à Madeleine Girou-Mirabal, père d’un petit garçon (Jean) âgé d’un an et bientôt d’un deuxième (Henri, mon père) – deux autres enfants suivront, Marcel et Hélène. Puis la mère meurt, après une longue maladie, et je sais que le temps s’arrêta en secret dans les cœurs.
L’architecte de la Maison indigène est algérois et, partant, algérien, donc français – puisqu’alors les deux termes sont synonymes, aux yeux de la métropole. Il a été nommé chef d’atelier d’architecture de l’École des beaux-arts d’Alger en 1928, est membre du Conseil des bâtiments civils de l’Algérie en 1932, et n’a quitté sa terre natale qu’en 1964 pour s’installer d’abord à Paris, rue Lhomond, puis définitivement à Gien, au bord de la Loire.
*
Le 1er janvier 1992 au matin, j’étais à Paris, chez moi, quand le téléphone sonna et qu’un de mes cousins m’apprit la mort de mon grand-père, l’architecte Léon Claro. J’avais perdu mon père six ans plus tôt, et tout décès, je l’avoue, me semblait une copie de copie, un bien pauvre apprêt venu recouvrir un mur déjà bien rongé. Un mur ? Non pas celui de la Maison indigène, mais plutôt de cette maison indigeste qu’était à mes yeux, à mes sens, à mes tripes, la famille. Je n’étais pas près d’en pousser les portes, n’ayant nulle envie à l’époque d’habiter cette demeure fantôme qu’on nomme origine. Rien de ce qui touchait à l’ascendance ne me parlait. J’étais sourd aux racines, aveugle aux jeux de lumière dans les hauts feuillages de l’arbre généalogique. Je ne voulais rien savoir de la source, sinon la confirmation que ses eaux étaient de toute éternité frelatées. Mon père n’a jamais chanté en ma présence les faits et larmes de sa première patrie, l’Algérie, à moins qu’à mots couverts, par des gestes ébauchés, des intonations détournées, il ne m’ait dit ce qu’il avait à dire. Viens d’où tu veux, va où tu peux.
*
Le hasard ne mordant jamais sans sourire un peu, il advint cela : l’an dernier, un de mes amis, Arno Bertina, m’envoya un e-mail amusé, dans lequel il me disait, plus ou moins en ces termes, “Alors comme ça tu ne
te contentes pas d’écrire des livres et de traduire des livres ! Tu construis aussi des maisons ! Et tu les fais visiter à Camus !” Il était en effet tombé, au cours de recherches, sur cette petite information qu’il avait eu à cœur de me donner en pâture :
L’un des premiers textes écrits par Camus a été “La Maison mauresque”, qui décrit une villa bâtie par Claro.
Je lui répondis que ce Claro-là était mon grand-père, ce à quoi il me fit cette réponse : “C’est seulement que je trouvais ce pli du temps magnifique à déplier : Camus écrivant son tout premier texte sur une œuvre de Claro !” Les choses auraient pu en rester là, tant m’indifféraient depuis des décennies tous ces signes émanant de lointaines archives. Mais cette histoire de “pli du temps magnifique à déplier” ne cessait de me convoquer et, dès lors, partout à l’horizon étriqué de ma conscience, je voyais se dresser, vibrante comme un mirage que ni le sable ni le temps ne parviennent à effacer, une vaste maison dont j’avais peut-être perdu les clés, et qui, pour mieux attirer mon attention, s’était repue autrefois d’un jeune homme prénommé Albert qui,comme tous les écrivains en devenir, n’attendait qu’une rencontre – un choc – un hasard – pour que l’encre en lui se mêle au sang.
Les sept sœurs - : La soeur disparue
De la même autrice, aux éditions Charleston
Les Sept Soeurs - Maia (tome 1), 2015
La Soeur de la tempête - Ally (tome 2), 2016
La Soeur de l’ombre - Star (tome 3), 2017
La Soeur à la perle - CeCe (tome 4), 2018
La Soeur de la Lune - Tiggy (tome 5), 2019
La Soeur du Soleil - Électra (tome 6), 2020
La Jeune Fille sur la falaise, 2016
L’Ange de Marchmont Hall, 2017
La Lettre d’amour interdite, 2018
Le Secret d’Helena, 2019
La Chambre aux papillons, 2020
Publications
Sous le nom de Lucinda Edmonds
En coulisse, J'ai lu, 1994 ((en) Lovers and Players, 1992), trad. Blandine Roques, 440 p. (ISBN 2-290-03676-5)
(en) Hidden Beauty, 1993
Sous le charme, J'ai lu, 1995 ((en) Enchanted, 1994), trad. Blandine Roques, 510 p. (ISBN 2-277-24001-X)
(en) Not Quite an Angel, 1995
(en) Aria, 1996
(en) Losing You, 1997
Sous les Feux de la rampe, J'ai lu, 2000 ((en) Playing With Fire, 1998), trad. Sophie Dalle, 348 p. (ISBN 2-290-30402-6)
(en) Seeing Double, 2000
Sous le pseudonyme de Lucinda Riley
La Maison de l'orchidée, City, 2012 ((en) The Orchid House (also known as Hothouse Flower), 2010), trad. Jocelyne Barsse, 589 p. (ISBN 978-2-8246-0227-1)
La Jeune fille sur la falaise, Charleston, 2013 ((en) The Girl on the Cliff, Penguin Books UK, 2011 (ISBN 0-241-95497-5)), trad. Jocelyne Barsse, 491 p. (ISBN 978-2-36812-041-5)
Le Domaine de l'héritière, City, 2013 ((en) The Light Behind the Window (also known as The Lavender Garden), Pan Books, 2012 (ISBN 1-447-21842-6)), trad. Jocelyne Barsse, 523 p. (ISBN 978-2-8246-0372-8)
La Rose de minuit, City, 2014 ((en) The Midnight Rose, Macmillan, 2013 (ISBN 1-447-23098-1)), trad. Jocelyne Barsse, 571 p. (ISBN 978-2-8246-0523-4)
L'Ange de Marchmont Hall, Charleston, 2017 ((en) The Angel Tree, Pan Books, 2014 (ISBN 1-447-28844-0)), trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld, 538 p. (ISBN 978-2-36812-180-1)
La Belle Italienne, Éditions Charleston, 2016 ((en) The Italian Girl (a rewrite of Aria), Pan Books, 2014 (ISBN 1-447-25707-3)), trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld, 510 p. (ISBN 978-2-36812-109-2)
Le secret d'Helena, Charleston, 2020 ((en) The Olive Tree (also published as Helena's Secret), Macmillan, 2016 (ISBN 1-509-82476-6)), trad. Élisabeth Luc, 504 p. (ISBN 978-2368125434)
La Lettre d'amour interdite, Charleston, 2018 ((en) The Love Letter (a rewrite of Seeing Double), 2018), trad. Laura Bourgeois, 558 p. (ISBN 978-2-36812-317-1)
La Chambre aux papillons, Charleston, 2020 ((en) The Butterfly Room, Macmillan, 2019 (ISBN 1-529-01499-9)), trad. Elisabeth Luc, 537 p. (ISBN 978-2-36812-506-9)
Lucinda Edmonds, connue sous le pseudonyme de Lucinda Riley, née le 16 février 1968 à Lisburn et morte le 11 juin 2021.
Lucinda Riley est née en Irlande et après une carrière d’actrice au théâtre, au cinéma et à la télévision, elle a écrit son premier roman à 24 ans. Ses livres ont depuis été traduits dans 37 langues et se sont vendus à 30 millions d’exemplaires dans le monde entier.
Elle figure fréquemment en tête de liste de bestsellers du New York Times et du Sunday Times.
Sa série Les Sept Sœurs, qui suit le destin de sœurs adoptées et s’inspire de la mythologie qui entoure la célèbre constellation des Pléiades, est devenue un véritable phénomène international, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Tous les tomes de la saga ont été n° 1 des ventes, et ils sont en cours d’adaptation pour une série télévisée.
Lucinda et sa famille partagent leur temps entre le Royaume-Uni et leur maison de campagne à West Cork, en Irlande, où Lucinda écrit ses romans.
....................................................................................................................................................RÉSUMÉ:
Le 7ème tome de la saga phénomène Les Sept Sœurs
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy et Électra. Recueillies bébés par l’énigmatique Pa Salt, les six soeurs d’Aplièse ont chacune découvert leur histoire. Mais elles ont toujours su qu’elles devraient être sept, tout comme les étoiles des Pléiades auxquelles elles doivent leurs prénoms. À présent que leur père a disparu, elles n’ont qu’un indice pour trouver leur dernière soeur : le dessin d’une bague en forme d’étoile à sept branches, sertie de diamants et d’émeraudes.
Nouvelle-Zélande, Canada, France, Irlande… Les six soeurs se lancent dans une quête haletante à travers le monde. Peu à peu, elles découvrent une magnifique histoire d’amour, de bravoure et de sacrifice, qui a commencé près d’un siècle plus tôt, alors que d’autres courageuses jeunes femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour d’elles…
....................................................................................................................................................
EXTRAITS;
PERSONNAGES
Atlantis
Pa Salt – père adoptif des sœurs (décédé)
Marina (Ma) – gouvernante des sœurs
Claudia – domestique à Atlantis
Georg Hoffman – avocat de Pa Salt
Christian – skipper
Les sœurs d’aplièse
Maia
Ally (Alcyone)
Star (Astérope)
CeCe (Célaéno)
Tiggy (Taygète)
Électra
Mérope (absente)
........................................;
Mary-Kate
Vallée de Gibbston,
Nouvelle-Zélande
Juin 2008
1
J e me souviens exactement de l’endroit où je me trouvais et de ce que je faisais quand j’ai vu mourir mon père. Je me tenais plus ou moins là où je suis en ce moment, penchée par-dessus la véranda en bois qui fait le tour de notre maison. J’observais les vendangeurs qui avançaient le long des rangées de pieds de vigne lourdement chargés de la récolte de cette année. J’étais sur le point de descendre les rejoindre quand, du coin de l’œil, j’ai vu la force de la nature qu’était mon père disparaître soudainement. J’ai d’abord cru qu’il s’était agenouillé pour ramasser une grappe de raisins qui traînait (il détestait le gaspillage sous toutes ses formes, un trait de caractère qu’il mettait sur le compte de la mentalité presbytérienne de ses parents écossais), mais ensuite, j’ai vu les vendangeurs des rangées voisines se précipiter vers lui. J’ai parcouru en courant la bonne centaine de mètres qui me séparaient de lui. Quand je l’ai rejoint, quelqu’un avait déjà arraché sa chemise et essayait de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque et du bouche-à-bouche, tandis qu’une autre personne appelait les secours. Il a fallu vingt minutes à l’ambulance pour arriver.
Alors qu’on le plaçait sur le brancard, j’ai compris à son teint cireux que plus jamais je n’entendrais le son de sa voix grave et puissante, qui pouvait être si sérieuse puis se transformer en joyeux éclat de rire l’instant suivant. Alors que les larmes ruisselaient sur mon visage, j’ai embrassé délicatement sa joue à la peau burinée, je lui ai murmuré que je l’aimais et je lui ai dit au revoir. Lorsque j’y repense, cette expérience a été totalement surréaliste. Le passage d’un être débordant d’énergie à un corps vide et sans vie est une transition inimaginable.
Après des mois passés à prétendre que ses douleurs dans la poitrine n’étaient qu’un problème d’indigestion, Papa s’était enfin laissé convaincre d’aller chez le médecin. On l’avait informé qu’il avait un taux élevé de cholestérol et qu’il devait suivre un régime strict. Ma mère et moi avions désespéré de le voir continuer à manger ce qu’il voulait et boire une bouteille de rouge de sa production chaque soir au dîner. Par conséquent, lorsque le pire est arrivé, cela n’aurait pas dû nous surprendre. Et pourtant… Peut-être que nous avions fini par croire qu’il était indestructible, une illusion entretenue par sa personnalité et sa bonhomie, même si nous n’étions qu’un tas de chair et d’os au bout du compte, comme ma mère l’avait lugubrement fait remarquer. Au moins, il avait vécu comme il l’entendait jusqu’à la fin. Et il avait soixante-treize ans, une réalité que je n’avais jamais bien assimilée étant donné sa force physique et sa joie de vivre.
Résultat : j’avais l’impression qu’on m’avait menti. J’avais vingt-deux ans et, même si j’avais toujours su que j’étais arrivée tard dans la vie de mes parents, l’importance de ce détail m’est apparue uniquement à la mort de mon père. Au cours des cinq mois qui ont suivi sa disparition, j’ai éprouvé une violente colère face à cette injustice : pourquoi n’étais-je pas née plus tôt ? Jack, mon grand frère, avait trente-deux ans. Il avait donc pu profiter de dix ans de plus avec notre père.
Naturellement, ma mère sentait que j’étais en colère, même si je n’en parlais pas. Et ensuite, je me sentais coupable, car ce n’était en aucun cas sa faute. Je l’aimais tant… Nous avions toujours été très proches et je voyais bien qu’elle souffrait, elle aussi. On a fait de notre mieux pour nous réconforter mutuellement et, tant bien que mal, avons surmonté cet obstacle ensemble.
Jack a été formidable. Il a passé la plupart de son temps à démêler l’horrible imbroglio administratif qui accompagne toujours un décès. Il a aussi endossé l’entière responsabilité du « Vignoble », l’affaire que nos parents avaient montée, partis de rien. Au moins, notre père avait bien préparé Jack pour assurer sa gestion.
Dès son plus jeune âge, Jack avait accompagné notre père dans ses précieuses vignes. En fonction de la météo, elles apportaient entre février et avril les grappes qui donnaient les délicieuses bouteilles (récemment récompensées) de pinot noir empilées dans l’entrepôt, prêtes à être exportées à travers la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Jack avait assisté à chaque étape du processus, et notre père lui avait transmis tant de connaissances qu’il aurait sans doute pu diriger toute l’exploitation dès l’âge de douze ans.
À son seizième anniversaire, Jack avait officiellement annoncé son désir de travailler avec notre père et de diriger Le Vignoble un jour, ce qui avait enchanté Papa. Il avait suivi des études de gestion à l’université et avait commencé à travailler à temps plein au domaine dès l’obtention de son diplôme.
— Il n’y a rien de mieux que de transmettre un héritage sain, avait déclaré notre père en trinquant à sa santé.
Après que Jack eut passé six mois dans un domaine viticole de la région d’Adelaide Hills en Australie, notre père avait décrété qu’il était prêt.
— Peut-être que tu te joindras à nous un jour, Mary-Kate. Trinquons, pourvu qu’il y ait des viticulteurs McDougal sur ces terres pour les siècles à venir !
Alors que Jack avait totalement embrassé le rêve de mon père, il m’était arrivé exactement le contraire. Peut-être que c’était justement parce que Jack était si fasciné à l’idée de produire de beaux vins, sans parler du fait qu’il avait un nez capable de repérer une mauvaise grappe à des kilomètres et que c’était un excellent homme d’affaires. Moi, en revanche… Certes, j’avais grandi en observant Jack et notre père tandis qu’ils patrouillaient entre les vignes et qu’ils travaillaient dans ce qu’on surnommait affectueusement « le labo » (qui, en réalité, n’était rien d’autre qu’un grand abri avec un toit en tôle), mais d’autres choses avaient éveillé mon intérêt. Désormais, je voyais Le Vignoble comme une entité séparée, sans lien avec moi ou mon avenir. Cela ne m’avait pas empêchée de travailler dans notre petite boutique durant les vacances scolaires et universitaires, ou d’aider quand on avait besoin de moi, mais le vin n’était pas ma passion. Même si mon père avait semblé déçu lorsque j’avais annoncé mon désir de poursuivre des études de musique, il avait respecté mon choix, me demandant simplement dans quel domaine je comptais exercer la musique. J’avais timidement avoué que j’espérais devenir chanteuse et écrire mes propres textes, à quoi mes parents m’avaient répondu qu’ils me soutenaient.
J’avais donc étudié la musique, arrêtant mon choix sur l’université Victoria de Wellington qui offrait un programme de classe internationale, et j’avais adoré chaque instant. Disposer d’un studio dernier cri où enregistrer mes chansons, être entourée d’autres étudiants qui vivaient pour la même passion… L’expérience avait été incroyable. J’avais constitué un duo avec Fletch, un ami formidable qui jouait de la guitare rythmique et dont la voix s’harmonisait bien avec la mienne. Avec moi au clavier, nous avions réussi à décrocher quelques dates à Wellington et nous avions joué lors du concert de notre remise de diplôme l’année précédente. C’était la première fois que ma famille m’entendait chanter et jouer en direct.
— Je suis tellement fière de toi, Mary-Kate, avait dit mon père en me serrant contre lui.
Ç’avait été un des meilleurs moments de ma vie.
— Et un an plus tard, je suis là, avec mon diplôme en poche et toujours entourée de vignes, grommelai-je toute seule. Sincèrement, MK, tu croyais vraiment que Sony viendrait te chercher et te supplierait d’accepter de signer un contrat avec eux ?
Depuis la fin de mes études, un an plus tôt, j’étais devenue de plus en plus déprimée par mes perspectives d’avenir et de carrière. En outre, la mort de mon père avait porté un énorme coup à ma créativité. C’était comme si j’avais perdu les deux amours de ma vie en même temps, un deuil d’autant plus douloureux qu’elles étaient inextricablement liées l’une à l’autre : c’était l’amour de mon père pour les femmes auteures-compositrices qui avait fait naître ma passion pour la musique. J’avais grandi au son des voix de Joni Mitchell et Joan Baez.
Mes études à Wellington m’avaient aussi fait prendre conscience d’à quel point mon enfance avait été idyllique et protégée, au sein de ce jardin d’Éden qu’était la vallée de Gibbston. Les montagnes qui s’élevaient autour de nous offraient une barrière physique rassurante, tandis que la terre fertile permettait à des fruits succulents de pousser en abondance.
Je me souvenais de Jack qui, adolescent, essayait de me persuader de manger les groseilles à maquereau qui poussaient au milieu des ronces derrière notre maison, et de son rire tandis que je recrachais le fruit aigre. Je vagabondais en toute liberté à l’époque, sans que mes parents s’inquiètent le moins du monde ; ils savaient que j’étais parfaitement à l’abri dans la superbe campagne environnante, jouant dans les ruisseaux d’eau claire et pure, courant après les lapins dans les hautes herbes. J’avais vécu dans ma bulle pendant que mes parents avaient été occupés dans le vignoble, plantant les vignes et les protégeant des animaux sauvages affamés, puis récoltant et pressant les grappes.
Le soleil éclatant du matin fut soudain éclipsé par un nuage, conférant à la vallée une nuance plus foncée de gris-vert. C’était un signe que l’hiver approchait et je me demandais sans cesse si j’avais pris la bonne décision en choisissant de rester ici. Deux mois plus tôt, ma mère avait pour la première fois évoqué l’idée de ce qu’elle avait appelé un « grand voyage » à travers le monde pour rendre visite à des amis qu’elle n’avait pas vus depuis des années. Elle m’avait proposé de me joindre à elle. À l’époque, j’espérais encore que la démo que nous avions faite avec Fletch et envoyée à des maisons de disques juste avant la mort de mon père éveillerait leur curiosité. Mais toutes les réponses que nous recevions disaient que notre musique n’était pas ce que les producteurs recherchaient pour le moment.
— Ma chérie, je n’ai pas besoin de te dire que l’industrie de la musique est l’une des plus difficiles dans lesquelles percer, avait dit ma emère.
— C’est justement pour ça que je ferais mieux de rester ici, avais-je répondu. On travaille sur de nouveaux morceaux avec Fletch. Je ne peux pas jeter l’éponge comme ça.
— Non, bien sûr. Au moins, tu as toujours Le Vignoble pour te retourner si jamais ça ne fonctionne pas, avait-elle ajouté.
Je savais qu’elle essayait seulement d’être gentille et que j’aurais dû être reconnaissante de pouvoir gagner ma vie en travaillant à la boutique et en donnant un coup de main avec la comptabilité. Mais tandis que je contemplais mon jardin d’Éden, je laissai échapper un gros soupir. L’endroit avait beau être aussi paisible et sûr que magnifique, la perspective de rester ici jusqu’à la fin de mes jours n’avait rien de réjouissant. Tout avait changé depuis mon départ à l’université, et encore plus depuis la mort de mon père. Comme si le cœur de cet endroit s’était arrêté de battre. Et l’absence de Jack n’arrangeait rien. Il avait prévu d’aller passer un été dans un domaine de la vallée du Rhône, en France.
Entre son départ et celui de ma mère la veille, je me sentais terriblement seule et en proie au danger de m’enfoncer encore plus dans la tristesse et la morosité.
— Tu me manques, Papa, murmurai-je en sortant pour aller petit-déjeuner, même si je n’avais pas faim.
Le silence qui régnait dans la maison n’aidait en rien mon humeur ; pendant toute mon enfance, elle avait grouillé de monde et d’activité. Quand ce n’étaient pas des fournisseurs ou des vendangeurs, c’étaient des gens venus visiter le domaine qui s’attardaient pour discuter. En plus d’offrir des échantillons de ses vins, mon père les invitait souvent à rester manger. L’hospitalité est une seconde nature chez les Néo-Zélandais et j’avais l’habitude de voir de parfaits étrangers se joindre à nous autour de notre grande table en pin avec vue sur la vallée. Ma mère parvenait toujours à faire apparaître en un instant des quantités de nourriture aussi énormes que délicieuses. Entre ça et la bonhomie de mon père, les rires et la bonne humeur étaient toujours présents au domaine.
L’énergie calme et positive de Jack me manquait également. Il adorait me taquiner, mais je savais aussi qu’il serait toujours là pour me défendre et me protéger.
J’attrapai la bouteille de jus d’orange dans le réfrigérateur et découpai des tartines dans la miche de pain de la veille qui avait déjà durci. Je les fis griller pour les rendre mangeables, puis j’entrepris de faire une liste de courses. Le supermarché le plus proche se trouvait à Arrowtown, et je devrais m’y rendre bientôt. Même si ma mère avait laissé des plats au congélateur, je n’aimais pas l’idée d’en décongeler rien que pour moi.
Tremblante de froid et armée de ma liste, j’allai dans le salon et m’assis dans le vieux canapé, devant le manteau de la grande cheminée en pierres volcaniques grises qui abondaient dans la région. Trente ans plus tôt, c’était une des choses qui avait convaincu mes parents d’acheter ce qui étais jadis une cabane perdue au milieu de nulle part, sans eau courante ni sanitaires. Mes parents adoraient se remémorer leur premier été ici, quand eux et Jack se lavaient dans le ruisseau qui cascadait entre les pierres derrière la maison, et quand un trou dans le sol faisait office de toilettes.
— Ça a été le meilleur été de ma vie, répétait toujours ma mère. Et l’hiver, c’était encore mieux grâce à la cheminée.
Ma mère était obsédée par les feux de cheminée. Tous les ans, dès la première gelée dans la vallée, Jack, notre père et moi étions chargés d’aller acheter du bois bien sec que nous empilions dans les alcôves de part et d’autre de la cheminée, puis Maman disposait des bûches dans l’âtre et procédait au rituel de ce que la famille appelait « la première lumière » lorsqu’elle craquait l’allumette. La cheminée brûlait ensuite joyeusement chaque jour des mois d’hiver, jusqu’à ce que les jacinthes des bois et les perce-neige – dont ma mère avait fait livrer des bulbes en provenance d’Europe – fleurissent sous les arbres lors de notre printemps à nous, entre septembre et novembre.
Peut-être que je devrais faire un feu, songeai-je en me remémorant la chaleur et la lumière qui m’accueillaient les jours de grand froid à mon retour de l’école. Si Papa était le cœur métaphorique du domaine, Maman et sa cheminée étaient à n’en pas douter ceux de la maison.
J’interrompis le cours de mes pensées, en proie au sentiment d’être beaucoup trop jeune pour me réfugier dans mes souvenirs d’enfance en quête de réconfort. Tout ce qu’il me fallait, c’était un peu de compagnie, voilà tout. Le problème, c’était que la plupart de mes camarades d’université étaient soit à l’étranger en train de profiter de leurs derniers moments de liberté avant de se poser et de trouver un emploi, soit déjà en train de travailler.
Même si nous avions une ligne fixe, la connexion Internet dans la vallée était sporadique. C’était un cauchemar d’envoyer des e-mails et Papa avait souvent dû se résoudre à parcourir la demi-heure de voiture qui nous séparait de Queenstown pour utiliser l’ordinateur de son ami agent de voyages. Il surnommait toujours notre vallée « Brigadoon », en référence à un vieux film sur un village qui ne se réveillait que pendant une journée tous les cent ans, afin de ne jamais être affecté par les changements du monde extérieur. Même si la vallée n’était pas Brigadoon (bien qu’elle ne changeât effectivement pas beaucoup), ce n’était certainement pas l’endroit où une auteure-compositrice-interprète en herbe allait entrer dans l’Histoire. Mes rêves avaient comme toile de fond Manhattan, Londres ou Sydney, où de grands immeubles accueillaient les bureaux de producteurs qui nous prendraient sous leur aile, Fletch et moi, et feraient de nous des stars…
La sonnerie du téléphone me sortit de ma rêverie et je me levai pour décrocher.
— Le Vignoble, j’écoute, récitai-je comme je l’avais toujours fait depuis que j’étais petite.
— MK, c’est Fletch, annonça-t-il en m’appelant par le surnom que tout le monde utilisait à l’exception de ma mère.
— Oh, salut. Des nouvelles ? demandai-je en sentant mon cœur s’emballer.
— Non, rien. Par contre, j’ai réfléchi à ta proposition de venir chez toi. J’ai quelques jours de congé et ça ne me ferait vraiment pas de mal de me mettre au vert.
Et moi, je donnerais tout pour en sortir, du vert…
— Génial ! Viens quand tu veux, je suis à la maison.
— Demain, qu’est-ce que tu en dis ? Je vais venir en voiture, alors ça me prendra la matinée, si Sissy survit bien sûr.
Sissy était le minivan qui nous emmenait à nos concerts. Il avait vingt ans, était rouillé de partout et crachait de la fumée par son pot d’échappement plus que douteux que Fletch avait temporairement réparé avec une ficelle. Je ne pouvais que croiser les doigts pour que Sissy résiste aux trois heures de route depuis Dunedin, où Fletch vivait avec sa famille.
— Alors je te vois plus ou moins à l’heure du déjeuner ?
— Oui. J’ai hâte ! Tu sais à quel point j’adore cet endroit. Peut-être qu’on pourrait passer quelques heures au piano et composer de nouveaux trucs ?
— Peut-être, grommelai-je – je n’étais pas particulièrement créative en ce moment. Au revoir Fletch, à demain.
Je raccrochai et regagnai le canapé, ragaillardie par la perspective de sa venue. Avec son sens de l’humour et sa positivité, il réussissait toujours à me dérider.
J’entendis un cri au dehors, puis un coup de sifflet. C’était comme ça que Doug, le gérant du domaine, nous prévenait de son arrivée. Je me levai pour me rendre sur la terrasse et aperçus Doug et un groupe de Polynésiens larges d’épaules qui marchaient à travers les vignes.
— Bonjour ! criai-je.
— Bonjour, MK ! J’emmène le groupe pour leur montrer où commencer à vendanger ce matin, expliqua Doug.
— D’accord, super. Bonjour tout le monde ! lançai-je aux membres de l’équipe, qui agitèrent la main.
Leur présence avait rompu le silence. Tandis que le soleil réapparaissait derrière un nuage, la vue d’autres personnes, ainsi que l’arrivée de Fletch prévue pour le lendemain, me remontèrent le moral.
.........................................;
2
Atlantis, lac de Genève, Suisse, juin 2008
—Tu es toute pâle, Maia. Est-ce que ça va ? demanda Ma en entrant dans la cuisine.
— Oui, j’ai juste mal dormi cette nuit. Je n’ai pas arrêté de penser à l’annonce de Georg. Une vraie bombe.
— C’est le moins qu’on puisse dire. Café ?
— Non, merci. Je vais prendre une camomille, s’il y en a.
— Bien sûr, qu’il y en a, fit Claudia.
Comme d’habitude, ses cheveux gris étaient ramenés en un chignon bien serré et son visage, normalement renfrogné, arborait un sourire à l’attention de Maia. Elle posa un panier rempli de petits pains frais et de pâtisseries sur la table de la cuisine.
— J’en bois une tous les soirs avant d’aller au lit, précisa-t-elle.
— Tu dois vraiment ne pas être en forme pour refuser ton café du matin, commenta Ma en s’en servant un.
— Les habitudes sont là pour qu’on rompe avec elles, répondit Maia d’un air las. Et puis je suis aussi sous le coup du décalage horaire, je te rappelle.
— Bien sûr, ma chérie. Après le petit déjeuner, pourquoi est-ce que tu ne retournerais pas te coucher pour essayer de redormir un peu ?
— Non, Georg a dit qu’il venait tout à l’heure pour parler de ce qu’on doit faire concernant… la sœur disparue. Ses sources sont fiables à quel point, selon toi ?
Ma soupira.
— Je n’en ai pas la moindre idée.
— Très fiables, intervint Claudia. Il n’aurait pas débarqué ici à minuit s’il n’était pas absolument sûr de ce qu’il avance.
— Bonjour, tout le monde ! lança Ally en entrant dans la pièce.
Bear était niché contre sa poitrine dans son porte-bébé, sa petite tête dodelinant tandis qu’il s’endormait. Un de ses poings minuscules était refermé autour d’une mèche des cheveux roux et bouclés d’Ally.
— Veux-tu que j’aille le mettre dans son lit ? proposa Ma.
— Non. À tous les coups, il va se réveiller et se mettre à hurler à la minute où il comprendra qu’il est tout seul. Oh, Maia, comme tu es blanche.
— C’est ce que je viens de lui dire, murmura Ma.
— Ça va, je vous assure, insista Maia. Au fait, Claudia, est-ce que Christian est dans les parages ?
— Oui, mais il est sur le point de prendre le bateau pour aller à Genève me faire des courses.
— Dans ce cas, pouvez-vous le prévenir que je pars avec lui ? J’ai des choses à faire en ville et si nous nous mettons en route bientôt, je serai de retour à temps pour voir Georg à midi.
— Bien sûr.
Claudia s’empara du téléphone pour appeler Christian. Ma posa une tasse de café devant Ally.
— J’ai à faire, je vous laisse profiter de votre petit déjeuner toutes les deux.
— Le bateau sera prêt à partir dans quinze minutes, annonça Claudia après avoir raccroché. Il faut que j’aille aider Marina.
Elle hocha la tête avant de quitter la cuisine.
— Tu es sûre que ça va ? demanda Ally à sa sœur une fois qu’elles se retrouvèrent seules. Tu es pâle comme un linge.
— Je t’en prie, Ally, n’en fais pas tout un plat. Peut-être que j’ai attrapé quelque chose dans l’avion, suggéra Maia entre deux gorgées de thé. C’est vraiment bizarre, ici, tu ne trouves pas ? Je veux dire, le fait que la vie continue comme quand Pa était vivant… Sauf qu’il ne l’est plus. J’ai l’impression de voir des trous béants en forme de Pa absolument partout.
— Je suis là depuis un moment, alors je suis plus ou moins habituée, mais tu as raison, oui.
— En parlant de mauvaise mine, Ally, je te trouve très amaigrie.
— Oh, j’ai juste perdu les kilos de la grossesse…
— Non. Rappelle-toi, la dernière fois que je t’ai vue, c’était il y a un an, quand tu es partie rejoindre Theo pour la Fastnet Race. Tu n’étais même pas encore enceinte à ce moment-là.
— En réalité, je l’étais, mais je ne le savais pas encore, fit remarquer Ally.
— Tu n’avais aucun symptôme ? Pas de nausées matinales, rien ?
— Pas au début, non. Seulement dès le troisième mois, si je me souviens bien. À partir de là, j’ai été malade comme un chien, par contre.
— Dans tous les cas, tu es bien trop mince.
— Je reconnais que quand je suis toute seule, je n’ai jamais le courage de me préparer un vrai repas. Sans compter que, même quand je m’assois pour manger, je dois aussitôt me relever pour m’occuper de monsieur.
Ally caressa affectueusement la joue de Bear.
— Ça doit être vraiment dur d’élever un enfant toute seule…
— Oui. Ce qui me pèse le plus, ce n’est pas le manque de sommeil, ni de devoir constamment nourrir ou changer Bear. C’est le fait de n’avoir personne à qui parler, surtout quand il est malade et que je me fais du souci. Je sais bien que j’ai mon frère Thom, mais depuis qu’il est chef d’orchestre adjoint du Philharmonique de Bergen, je ne le vois presque jamais, à part les dimanches. Et encore, quand il n’est pas en tournée à l’étranger. C’est pour ça que c’est génial d’avoir Ma. C’est un puits de science quand il s’agit des bébés.
— C’est la grand-mère modèle, dit Maia avec un sourire. Pa aurait été fou de joie d’être grand-père, Bear est vraiment adorable. Mais, excuse-moi, il faut que je monte me préparer.
Alors que Maia se levait, Ally prit la main de sa grande sœur dans la sienne.
— C’est vraiment bon de te voir. Tu m’as beaucoup manqué.
— Toi aussi, répondit Maia en déposant un baiser sur la tête de sa sœur. À tout à l’heure.
— Ally ! Maia ! Georg est ici ! cria Ma depuis le bas de l’escalier principal.
Il était midi. Un « j’arrive » étouffé lui parvint depuis l’étage supérieur.
— Vous vous souvenez de la fois où Pa Salt vous a apporté un vieux mégaphone en cuivre pour Noël ? demanda Georg en souriant tandis qu’il suivait Ma à travers la cuisine, jusqu’à la terrasse baignée de soleil.
Il semblait beaucoup plus calme que la veille au soir. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés et ramenés en arrière et son costume rayé impeccable, accessoirisé avec bon goût d’une pochette assortie.
— Je m’en souviens, oui, répondit Ma en indiquant à l’avocat un siège sous le parasol. Sauf que ça n’a servi à rien, car les filles écoutaient déjà leur musique à fond, ou jouaient de leur instrument, ou étaient en train de se disputer. Quand on était dans le grenier, on se serait cru dans la tour de Babel. Mais j’ai adoré chacun de ces instants. Bref, j’ai du sirop de fleur de sureau préparé par Claudia ou une bouteille bien fraîche de votre rosé de Provence favori. Qu’est-ce que vous préférez ?
— Par une si belle journée, je vais opter pour le rosé, d’autant plus que je n’en ai pas encore bu depuis le début de l’été. Merci, Marina. Est-ce que vous m’accompagnez ?
— Ce ne serait pas raisonnable. J’ai du travail à faire cet après-midi et…
— Enfin, vous êtes française ! Ce n’est pas un petit verre de rosé qui va vous empêcher de travailler. De fait, j’insiste, trancha Georg au moment où Maia et Ally arrivaient sur la terrasse. Bonjour, mesdemoiselles. Est-ce que je peux vous offrir un verre de rosé ?
— J’en veux bien un petit, merci, Georg, répondit Ally en s’asseyant. Peut-être que ça aidera Bear à dormir cette nuit, ajouta-t-elle dans un petit rire.
— Pas pour moi, merci, dit Maia.
Elle s’assit à son tour et regarda autour d’elle, admirative.
— J’avais presque oublié à quel point Atlantis était belle. Au Brésil, tout est tellement… grand. Les gens sont bruyants, les couleurs de la nature sont vives, la chaleur est écrasante. Ici, tout a l’air doux et délicat en comparaison.
— C’est paisible, c’est certain, confirma Ma. Nous avons une chance folle de vivre au milieu de tant de beauté.
— Si vous saviez comme la neige m’a manqué pendant l’hiver, avoua Maia.
— Tu devrais venir passer un hiver en Norvège, ça te vaccinerait, répliqua Ally en souriant. Quoique, il y a pire que la neige : la pluie. Il pleut beaucoup plus à Bergen qu’il n’y neige. Enfin bref. Georg, savez-vous ce qu’il convient de faire après ce que vous nous avez révélé hier soir ?
— Je n’y ai pas vraiment réfléchi, mais je pense qu’en premier lieu, l’un de nous devrait se rendre à l’adresse que j’ai, afin de vérifier si cette femme est bien votre sœur disparue.
— Et comment saurons-nous que c’est bien elle ? demanda Maia. A-t-on un moyen quelconque de l’identifier ?
— J’ai le dessin d’un bijou très particulier qu’elle aurait reçu en cadeau. Si elle l’a en sa possession, alors nous aurons sans l’ombre d’un doute la confirmation que c’est elle. J’ai apporté ce dessin avec moi.
L’avocat glissa la main dans sa fine serviette en cuir et en ressortit une feuille de papier, qu’il plaça sur la table pour que toutes puissent la voir.
Ally l’inspecta attentivement, tandis que Maia regardait par-dessus son épaule.
— Ce dessin a été réalisé de mémoire. Les pierres de la monture sont des émeraudes et la pierre du milieu est un diamant.
— C’est magnifique, souffla Ally. Regarde, Maia, c’est en forme d’étoile, avec…
Elle s’interrompit pour compter.
— Avec sept branches.
— C’est très original, en effet. Georg, savez-vous qui l’a fabriquée ? interrogea Maia.
— Hélas, je l’ignore.
— Est-ce que c’est Pa qui l’a dessinée ? demanda encore Maia.
— Oui.
— Sept branches d’une étoile pour sept sœurs… murmura Ally.
— Georg, vous avez dit hier soir qu’elle s’appelait Mary, reprit Maia.
— C’est exact.
— Est-ce que Papa l’a trouvée puis a voulu l’adopter, mais en a été empêché par quelque chose et l’a perdue ?
— Tout ce que je sais, c’est que juste avant son… départ, il a reçu des informations et m’a demandé de creuser. Après avoir découvert son lieu de naissance, il m’a fallu un an pour retrouver la trace de l’endroit où je pense qu’elle est aujourd’hui. Au fil des années, j’ai suivi de nombreuses fausses pistes, mais cette fois, votre père était catégorique quant à la fiabilité de sa source.
— Qui était cette source ? s’enquit Maia.
— Il ne me l’a pas dit.
Maia soupira.
— Si c’est la sœur disparue, c’est vraiment dommage qu’elle ait été localisée seulement après la mort de Pa, après toutes ces années passées à la rechercher.
— Ce serait merveilleux si c’était elle et si nous pouvions la faire venir à temps à Atlantis pour embarquer sur le Titan et aller déposer la couronne de fleurs, déclara Ally.
Maia sourit.
— C’est vrai. Sauf qu’il y a un gros problème : d’après vos informations, Georg, cette Mary n’habite pas la porte à côté, loin de là. Et la croisière en Grèce est prévue pour dans moins de trois semaines.
— En effet, et malheureusement, je suis trop pris en ce moment pour aller chercher Mary moi-même, déplora Georg.
Comme pour confirmer ses dires, son portable sonna. Georg s’excusa et quitta la table.
Ma finit par briser le silence.
— Est-ce que je peux suggérer quelque chose ?
— Bien sûr, Ma, vas-y, l’encouragea Maia.
— Comme Georg nous a annoncé hier soir que Mary vivait en Nouvelle-Zélande, j’ai effectué quelques recherches ce matin pour voir quelle était la distance entre Sydney et Auckland. Étant donné que…
— CeCe est en Australie, finit Maia à sa place. J’y ai pensé aussi hier soir.
— Auckland est à trois heures d’avion de Sydney, continua Ma. Si CeCe et son amie Chrissie partaient un jour plus tôt que prévu, peut-être qu’elles pourraient faire un détour par la Nouvelle-Zélande pour voir si cette Mary est bien la personne que Georg croit.
— C’est une excellente idée, Ma ! s’enthousiasma Ally. Je me demande si CeCe serait d’accord. On sait à quel point elle déteste prendre l’avion.
— Si on lui explique, je suis sûre qu’elle acceptera. Ce serait tellement beau de réunir les sept sœurs pour le mémorial de votre père.
— La vraie question, c’est : est-ce que Mary connaît ne serait-ce que l’existence de Pa et de notre famille ? demanda Ally. C’est vrai que c’est déjà rare que nous soyons réunies toutes les six, et ce serait le moment parfait, si toutefois c’est la bonne personne. Et si elle est d’accord pour nous rencontrer, bien sûr. À mon avis, la première chose à faire est de contacter CeCe, et rapidement, car il est déjà tard en Australie.
— Qu’est-ce qu’on fait pour les autres ? s’enquit Maia. Est-ce qu’on leur en parle ?
— On devrait envoyer un mail à Star, Tiggy et Électra pour leur expliquer ce qui se passe. Est-ce que tu veux appeler CeCe, Maia, ou je m’en occupe ? proposa Ally.
— Je veux bien que tu l’appelles. Si ça ne dérange personne, je vais aller m’allonger un peu avant le déjeuner, j’ai encore la nausée.
Ma se leva.
— Ma pauvre chérie. Tu es verdâtre.
— Je vais rentrer avec toi pour appeler CeCe, décida Ally, en espérant qu’elle ne soit pas partie dans l’Outback pour une de ses expéditions peinture avec son grand-père. Apparemment, il n’y a pas du tout de réseau dans son chalet.
Claudia apparut sur la terrasse.
— Je vais préparer le déjeuner.
Elle se tourna vers Georg, qui venait de revenir.
— Est-ce que vous souhaitez vous joindre à nous ?
— Non, merci. J’ai des affaires urgentes à régler et je dois partir immédiatement. Qu’avez-vous décidé, Marina ?
Alors que Maia et elle quittaient la terrasse, Ally remarqua que des gouttes de sueur s’étaient formées sur le front de Georg et qu’il semblait distrait.
— Nous allons contacter CeCe pour voir si elle veut bien se rendre à l’adresse que vous avez, répondit Ma. Georg… est-ce que vous êtes sûr que c’est elle ?
— Disons que d’autres personnes qui le sont m’en ont convaincu. J’adorerais rester pour discuter et vous aider, Marina, mais il faut vraiment que j’y aille.
— Ne vous en faites pas, je suis persuadée que les filles peuvent gérer ça. Elles sont adultes à présent, et très débrouillardes.
Ma posa une main sur le bras de Georg dans un geste rassurant.
— Essayez de vous détendre. Vous semblez très stressé.
Il hocha la tête en soupirant.
— Je vais essayer, Marina. Je vais essayer.
Ally trouva le numéro de portable australien de CeCe dans son carnet d’adresses et décrocha le téléphone du couloir.
— Allez, réponds… marmonna-t-elle entre ses dents.
La tonalité retentit cinq fois, six fois… Elle savait que c’était inutile de laisser un message vocal. CeCe ne les écoutait presque jamais.
— Bon sang, grommela-t-elle quand le répondeur se déclencha.
Elle reposa le combiné et s’apprêtait à aller à l’étage pour nourrir Bear quand le téléphone sonna.
— Allô ?
— Allô, Ma ?
— CeCe ! C’est moi, Ally. Merci d’avoir rappelé !
— J’ai vu que c’était le numéro d’Atlantis. Est-ce que tout va bien ?
— Oui, tout va bien. Maia est arrivée hier, c’est vraiment génial de la voir. Quand décolles-tu pour Londres exactement ?
— On part d’Alice Springs après-demain pour rejoindre Sydney, puis direction Londres. Mais c’est l’affaire de quelques jours seulement, le temps d’organiser la vente de mon appartement et de voir Star. J’appréhende de prendre l’avion, comme d’habitude.
— Je m’en doute. Écoute, CeCe, Georg nous a annoncé quelque chose hier. Ne t’inquiète pas, ce n’est rien de grave, mais c’est une sacrée nouvelle. Si ça se confirme, en tout cas.
— De quoi s’agit-il ?
— Il a reçu des informations concernant… notre sœur disparue. Il pense qu’elle vit peut-être en Nouvelle-Zélande.
— Tu veux dire la célèbre Septième Sœur ? Waouh ! Sacrée nouvelle, comme tu dis ! Comment est-ce que Georg l’a trouvée ?
— Il est resté très évasif. Et donc…
— Tu voudrais me demander si je peux faire un saut en Nouvelle-Zélande pour la rencontrer, pas vrai ?
Ally sourit dans le combiné.
— Bien joué, Sherlock. Je sais que ça rallongerait ton voyage, mais c’est toi la plus proche, et de loin. Ce serait tellement merveilleux qu’elle soit avec nous toutes pour aller déposer la couronne de fleurs de Pa.
— C’est sûr, mais on ignore tout d’elle. Est-ce qu’elle est au courant de notre existence, au moins ?
— On ne sait pas trop. Georg dit qu’il a uniquement un nom et une adresse. Oh, et le dessin d’une bague qu’elle posséderait et qui prouverait que c’est elle.
— Tu as l’adresse ? C’est grand, la Nouvelle-Zélande.
— Je ne l’ai pas sur moi, mais je peux te passer Georg. Georg ? appela Ally alors que ce dernier venait d’émerger de la cuisine. C’est CeCe. Elle voudrait savoir où habite Mary.
— Mary ? C’est son nom ? intervint CeCe.
— Apparemment, oui. Je te passe Georg.
L’avocat s’empara du combiné et communiqua l’adresse.
— Merci, CeCe, déclara-t-il. Tous les frais seront pris en charge par la fiducie. Giselle, ma secrétaire, va réserver les billets d’avion. Je dois partir, je vous repasse votre sœur.
Alors qu’il tendait le combiné à Ally, il ajouta :
— Vous avez le numéro de mon bureau. Contactez Giselle si vous avez besoin de quoi que ce soit. Au revoir.
— Très bien. CeCe, je suis là, reprit Ally après avoir fait signe à Georg. Est-ce que tu sais où ça se trouve, en Nouvelle-Zélande ?
— Ne bouge pas. Je vais demander à Chrissie.
Des bruits étouffés de conversation lui parvinrent, puis la voix de CeCe retentit à nouveau :
— Chrissie dit que c’est tout en bas de l’île du Sud. Elle pense qu’on devrait pouvoir prendre l’avion jusqu’à Queenstown depuis Sydney, ça serait beaucoup plus simple que d’aller à Auckland. On va se renseigner.
— Génial. Alors tu es d’accord ?
— Tu me connais, même en avion, j’adore les voyages et l’aventure. Et puis je ne suis jamais allée en Nouvelle-Zélande, c’est l’occasion !
— Formidable ! Merci, CeCe. Si c’est plus simple pour toi, envoie-moi les détails par mail et j’appellerai la secrétaire de Georg pour qu’elle réserve les billets. De mon côté, je t’envoie une photo du dessin de la bague.
— D’accord. Est-ce que Star est au courant ?